Abus de biens sociaux : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 24 septembre 2025, Pourvoi n° 24-84.249
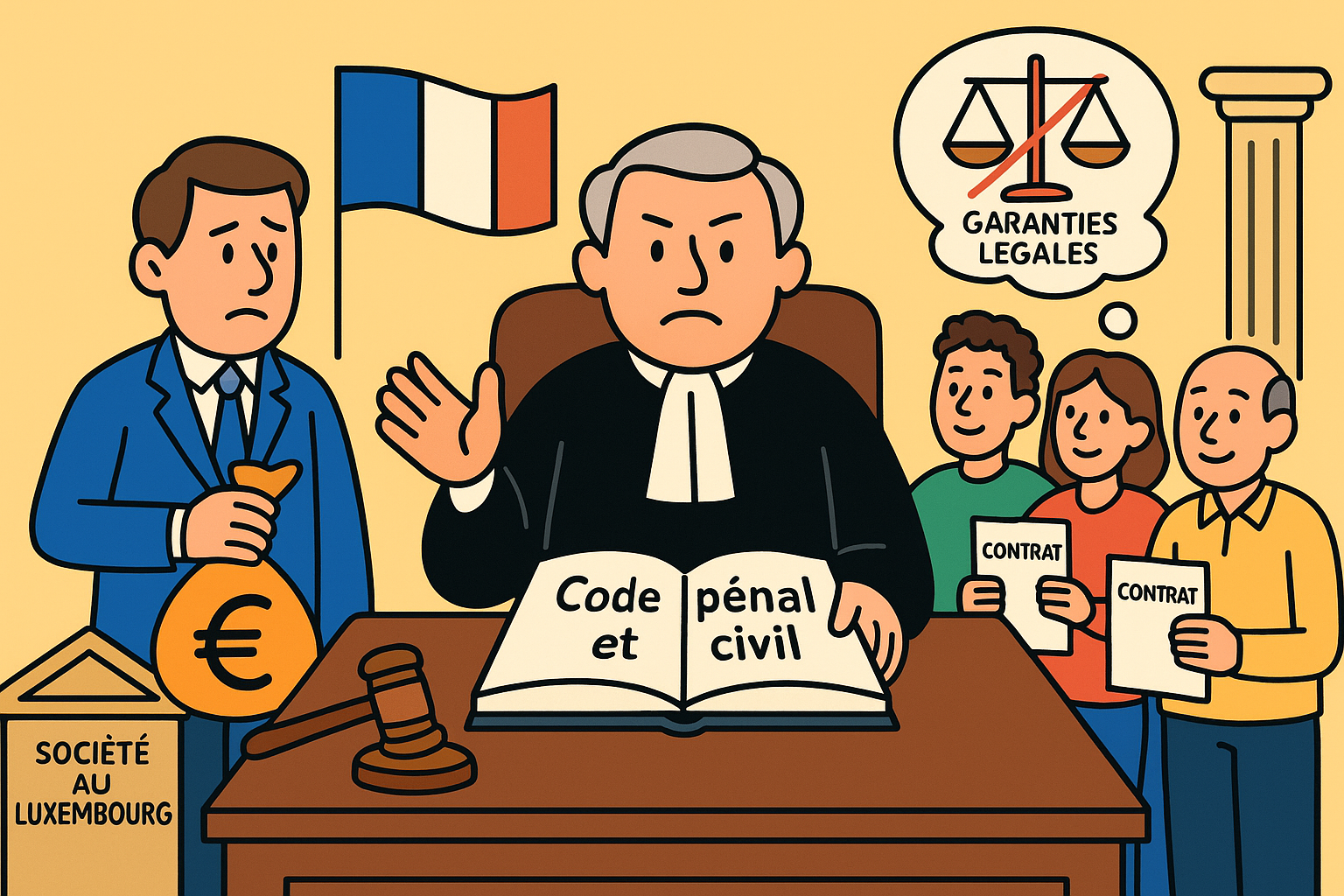
La Cour de cassation s'est prononcée sur les abus de biens sociaux aggravé, l'exercice illégal de la profession de prestataire de services de paiement, la recevabilité de l'action civile, et lien de causalité.
I. Rappel des faits
Un dirigeant social, M. [R], a été poursuivi pour plusieurs infractions financières. Il lui était notamment reproché d'avoir commis un abus de biens sociaux au préjudice de la société [1] en versant une somme de 32 000 euros à une société [2] située au Luxembourg, qu'il dirigeait également. Par ailleurs, il lui était reproché d'avoir exercé une activité de prestataire de services de paiement sans disposer de l'agrément nécessaire, causant des préjudices financiers à plusieurs investisseurs.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
M. [J] [R] a été condamné par la cour d'appel de Chambéry le 28 septembre 2023 à des peines d'emprisonnement, d'amende et à des interdictions professionnelles pour abus de biens sociaux, abus de biens sociaux aggravé et exercice illégal de la profession de prestataire de services de paiement. Il a également été condamné à indemniser plusieurs parties civiles.
Devant la Cour de cassation, le demandeur soutenait principalement deux arguments :
1. Sur l'abus de biens sociaux aggravé, il prétendait que la circonstance aggravante d'interposition d'une personne morale établie à l'étranger n'était pas caractérisée, la société luxembourgeoise [2] étant la destinataire directe des fonds et non une entité "interposée".
2. Sur les intérêts civils, il arguait que la cour d'appel ne pouvait le condamner à réparer le préjudice des investisseurs sans établir un lien de causalité direct entre un manquement précisément identifié aux obligations légales des prestataires de services de paiement et le préjudice financier allégué.
III. Thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d'appel de Chambéry avait retenu que la condamnation sur les intérêts civils était justifiée par le simple fait que l'infraction d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services de paiement avait « privé les souscripteurs des garanties posées par la loi dans l'intérêt des consommateurs » (point 18). Cette privation de garantie suffisait, selon elle, à établir le préjudice et son lien avec l'infraction, justifiant l'indemnisation des victimes.
IV. Problème de droit
La simple constatation qu'une infraction d'exercice illégal d'une profession réglementée a privé les victimes des garanties légales suffit-elle à caractériser un préjudice indemnisable en lien de causalité direct avec l'infraction, ou les juges du fond doivent-ils identifier un manquement spécifique aux obligations statutaires et le relier directement à la perte financière subie ?
V. Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel, uniquement sur les dispositions relatives aux intérêts civils.
- Visa : Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale, et 1240 du code civil.
- Réponse : La Cour de cassation répond que la seule affirmation selon laquelle l'infraction a privé les victimes des garanties légales est insuffisante pour justifier la condamnation à des dommages et intérêts (point 19). Elle énonce que les juges du fond doivent impérativement « établir un lien direct entre au moins l'un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué ». Elle ajoute que ce préjudice « n'équivaut pas nécessairement au montant des sommes investies et perdues, compte tenu notamment de l'aléa inhérent à tout placement financier » (point 20).
Commentaire d'arrêt
Cet arrêt de la chambre criminelle du 24 septembre 2025 offre un double éclairage sur le contentieux des infractions financières. Si la Cour de cassation valide une interprétation large des éléments constitutifs de certaines infractions, consolidant ainsi la répression pénale (I), elle rappelle avec une fermeté accrue les exigences probatoires en matière de réparation civile, protégeant ainsi le prévenu d'une indemnisation automatique (II).
I. La consolidation de la répression des infractions financières
La Cour de cassation, en rejetant les moyens relatifs à la culpabilité du prévenu, confirme une approche rigoureuse de la qualification des infractions financières, tant sur le fond de l'abus de biens sociaux aggravé (A) que sur les aspects procéduraux liés à la requalification (B).
A. L’interprétation extensive de la notion d’interposition étrangère
Le demandeur au pourvoi contestait l'application de la circonstance aggravante prévue à l'article L. 242-6 du code de commerce, arguant que la société luxembourgeoise bénéficiaire des fonds n'était qu'une simple destinataire et non une entité "interposée". La Cour de cassation balaye cet argument en précisant que « l'interposition d'une personne morale de droit étranger [...] s'entend de l'interposition entre la société victime et le dirigeant prévenu » (point 8).
"La Cour de cassation balaye cet argument en précisant que « l'interposition d'une personne morale de droit étranger [...] s'entend de l'interposition entre la société victime et le dirigeant prévenu »"
Cette solution clarifie le champ d'application de la circonstance aggravante "offshore". Peu importe que la société étrangère soit le bénéficiaire final des fonds ; ce qui compte, c'est qu'elle ait servi d'écran, même transparent, entre la société française spoliée et son dirigeant, qui se trouve également être le dirigeant de l'entité étrangère. Cette lecture, conforme à l'objectif du législateur de 2013 de lutter plus efficacement contre l'opacité des montages internationaux (Code de commerce - Article - L242-6), empêche les dirigeants de se prévaloir d'une lecture formaliste du terme "interposition" pour échapper à la répression aggravée.
B. Le rejet pragmatique du moyen procédural relatif à la requalification
Le prévenu tentait également d'obtenir l'annulation de sa condamnation pour exercice illégal de l'activité de prestataire de services de paiement en invoquant une requalification irrégulière des faits, initialement poursuivis sous la qualification d'exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en financement participatif (point 10). La Cour de cassation écarte ce moyen en deux temps.
D'une part, elle le déclare irrecevable car "nouveau et mélangé de fait", la requalification ayant déjà été opérée en première instance sans que le prévenu ne la conteste utilement en appel (point 11). D'autre part, elle juge que l'arrêt d'appel n'était ni ambigu ni contradictoire, la mention de l'ancienne qualification étant "surabondante" (point 12). Cette décision témoigne d'un certain pragmatisme : dès lors que le débat contradictoire a pu avoir lieu sur les faits et que la décision finale est claire, les imperfections formelles ou les mentions superflues ne suffisent pas à entraîner la nullité de la condamnation.
II. Le rappel strict des conditions de la réparation civile
Si la culpabilité pénale est maintenue, l'apport majeur de l'arrêt réside dans la cassation prononcée sur les intérêts civils. La Cour de cassation censure la cour d'appel pour son manque de rigueur dans la caractérisation du lien de causalité, rappelant que l'indemnisation des victimes d'infractions financières n'est pas automatique. Elle dénonce ainsi une motivation insuffisante (A) et pose une double exigence pour l'avenir (B).
A. L’insuffisance de la seule privation des garanties légales comme fondement de l’indemnisation
La cour d'appel s'était contentée d'affirmer que l'infraction avait « privé les souscripteurs des garanties posées par la loi » pour justifier l'indemnisation (point 18). Pour la Cour de cassation, cette motivation est insuffisante au regard des articles 2 du code de procédure pénale et 1240 du code civil (point 14). En effet, l'article 2 CPP exige que le dommage réparable ait été "directement causé par l'infraction" (Code de procédure pénale - Article - 2).
"elle s'inscrit dans une jurisprudence constante qui exige des juges du fond une démonstration concrète du lien de causalité, notamment en matière de préjudices financiers"
Une formule aussi générale que la "privation des garanties" ne permet pas d'établir ce lien direct et spécifique. Elle s'apparente à un postulat, assimilant l'existence de l'infraction à la cause certaine et unique du préjudice, ce que la Cour de cassation refuse. Ce faisant, elle s'inscrit dans une jurisprudence constante qui exige des juges du fond une démonstration concrète du lien de causalité, notamment en matière de préjudices financiers (Cour de cassation - 27 mars 2024 - 22-84.496).
B. L’exigence d'une double caractérisation : un manquement spécifique et un préjudice distinct de l'aléa financier
En censurant les juges du fond, la Cour de cassation leur fixe une feuille de route précise. Pour qu'une condamnation sur les intérêts civils soit justifiée, les juges doivent désormais :
1. Identifier un manquement précis : Ils doivent établir un lien « entre au moins l'un des manquements sanctionnés, précisément identifié » et le préjudice (point 20). Il ne suffit plus de viser le délit d'exercice illégal dans son ensemble ; il faut pointer une violation spécifique des obligations statutaires, comme celles relatives à la protection des fonds des clients (Code monétaire et financier - Article - L522-17) ou à la gestion des risques de sécurité (Code monétaire et financier - Article - L521-9).
2. Distinguer le préjudice de l'aléa : La Cour rappelle avec force que le préjudice indemnisable « n'équivaut pas nécessairement au montant des sommes investies et perdues, compte tenu notamment de l'aléa inhérent à tout placement financier » (point 20). La réparation ne peut donc consister en une simple restitution des fonds perdus. Les juges devront évaluer ce qui, dans la perte subie par l'investisseur, relève directement de la faute pénale (par exemple, la perte d'une chance d'éviter le risque par une meilleure information ou la perte de fonds due à l'absence de comptes ségrégués) et ce qui relève du risque normal du marché que l'investisseur aurait de toute façon couru.
En posant cette double exigence, la Cour de cassation affine considérablement le contrôle de la motivation en matière de réparation du préjudice financier et impose aux juridictions du fond une analyse beaucoup plus fine, au bénéfice de la sécurité juridique.