Accident de la circulation : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2025, Pourvoi n° 20-86.015
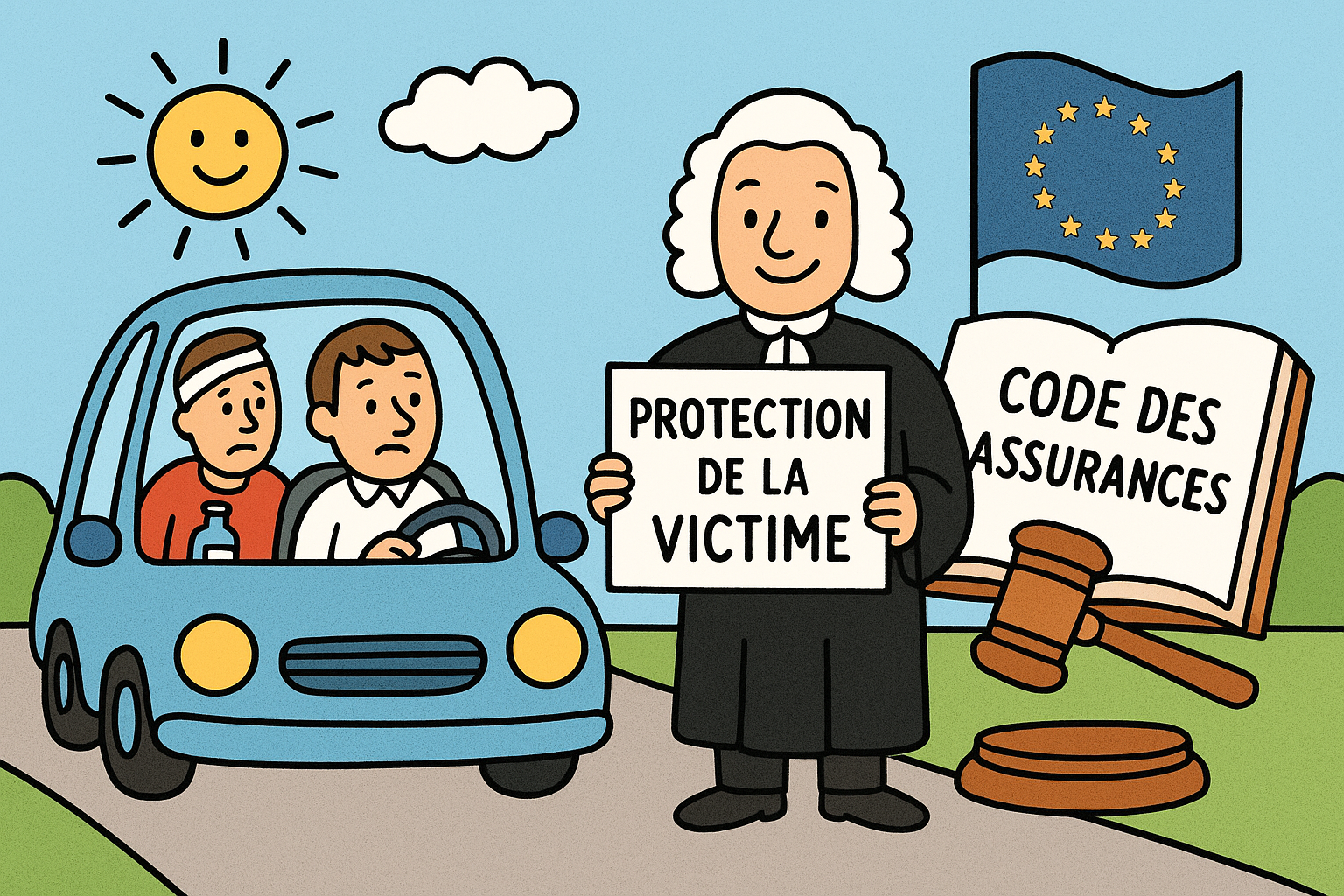
I. Rappel des faits
Le 28 décembre 2013, M. [K] [B] a été victime de blessures dans un accident de la circulation. Il était passager du véhicule impliqué, dont il était également le propriétaire et le souscripteur du contrat d'assurance auprès de la société [4]. Le véhicule était conduit par M. [T] [X] en état d'ivresse.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
1. Tribunal correctionnel : A déclaré M. [X] coupable de blessures involontaires. Sur le plan civil, il a déclaré le jugement opposable à l'assureur, la société [4].
2. Tribunal (statuant sur intérêts civils) : A accueilli l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la société [4] pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur (M. [B]) et a mis l'assureur hors de cause.
3. Cour d'appel de Lyon (21 octobre 2020) : Saisie par M. [X], la société [2] et le FGAO, la cour d'appel a infirmé le jugement. Elle a constaté la fausse déclaration intentionnelle de M. [B] et a prononcé la nullité du contrat d'assurance. Cependant, se fondant sur la primauté du droit de l'Union européenne, elle a jugé cette nullité inopposable à la victime, M. [B], le qualifiant de tiers victime, et a donc déclaré le jugement opposable à la société [4].
4. Cour de cassation : La société [4] (l'assureur) a formé un pourvoi, soutenant que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle doit être opposable au cocontractant, même s'il est la victime de l'accident.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La thèse de la société [4], demanderesse au pourvoi, est que la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, prévue par l'article L. 113-8 du code des assurances, est opposable au souscripteur fautif. Selon elle, le fait que ce souscripteur soit également la victime de l'accident ne lui confère pas la qualité de "tiers" pouvant bénéficier du régime de protection de l'inopposabilité des exceptions de garantie. En d'autres termes, on ne peut être à la fois partie à un contrat nul pour sa propre fraude et tiers protégé par ce même contrat.
IV. Problème de droit
La nullité d'un contrat d'assurance automobile, sanctionnant la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur sur l'identité du conducteur habituel, peut-elle être opposée à ce même souscripteur lorsqu'il est également passager et victime de l'accident causé par le véhicule assuré ?
V. Réponse donnée par la Cour
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que la cour d'appel a correctement justifié sa décision en déclarant la nullité du contrat d'assurance inopposable à M. [B] en sa qualité de tiers lésé.
La Cour fonde sa décision sur l'interprétation de la directive 2009/103/CE par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 19 septembre 2024 (C-236/23). Elle en déduit que, sauf abus de droit, la nullité du contrat pour fausse déclaration ne peut être opposée à la victime passager, même si cette dernière est également le souscripteur auteur de la déclaration frauduleuse. Une telle opposabilité limiterait de manière disproportionnée le droit de la victime à l'indemnisation et priverait la directive de son effet utile.
La Cour précise qu'en l'espèce, l'exception d'abus de droit n'est pas applicable, car l'objectif de protection des victimes poursuivi par la réglementation de l'Union est atteint dès lors que M. [B] sollicite une indemnisation en sa qualité de passager victime.
Commentaire d'arrêt
Cet arrêt de la chambre criminelle du 23 septembre 2025, rendu à la suite d'une saisine pour avis et d'une question préjudicielle à la CJUE, vient clarifier l'articulation délicate entre la sanction de la fraude à l'assurance et l'impératif de protection des victimes d'accidents de la circulation. En consacrant la primauté du droit à indemnisation de la victime, même lorsqu'elle est l'auteur d'une fausse déclaration intentionnelle, la Cour de cassation confirme l'influence déterminante du droit de l'Union européenne en la matière (I). Cette solution, qui limite l'efficacité de la sanction de nullité, est toutefois encadrée par la notion d'abus de droit, dont le rôle de garde-fou est réaffirmé (II).
I. La consécration de la primauté du droit à indemnisation de la victime sur la sanction de la fraude contractuelle
Par cette décision, la Cour de cassation entérine une solution protectrice des victimes qui fait prévaloir leur droit à réparation sur la sanction de la nullité du contrat d'assurance (art. L. 113-8 du code des assurances). Cette primauté est rendue possible par une extension de la notion de "tiers victime" (A) qui est la conséquence directe d'une application de la jurisprudence européenne (B).
A. L'extension de la notion de "tiers victime" au souscripteur fautif
Le point central de l'arrêt réside dans la confirmation que la qualité de "tiers lésé" peut être reconnue au souscripteur lui-même, dès lors qu'il est victime en tant que passager. La cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, avait déjà jugé que le statut hybride de M. [B] (preneur d'assurance, propriétaire, et passager victime) "ne permet pas de l'exclure de la qualité de tiers victime" (point 12 de l'arrêt).
"Le point central de l'arrêt réside dans la confirmation que la qualité de "tiers lésé" peut être reconnue au souscripteur lui-même, dès lors qu'il est victime en tant que passager"
Ce faisant, la Cour opère une dissociation des qualités juridiques d'une même personne. En tant que cocontractant, M. [B] est fautif et son contrat est nul. Mais en tant que victime passagère, il bénéficie du régime d'ordre public de protection des victimes d'accidents de la circulation, issu du droit de l'Union. L'arrêt confirme que c'est cette seconde qualité qui prévaut pour l'ouverture du droit à indemnisation. L'objectif de protection des victimes, rappelé au point 18 de l'arrêt, justifie que la personne physique blessée soit indemnisée, indépendamment de ses manquements contractuels en tant que preneur d'assurance.
B. Une application directe de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne
Cette solution n'est pas une création spontanée de la Cour de cassation. Elle est l'aboutissement d'un "dialogue des juges" exemplaire. L'arrêt met en évidence tout le processus : une question posée pour avis à la deuxième chambre civile (point 6), une question préjudicielle renvoyée par cette dernière à la CJUE (point 7), la réponse de la CJUE du 19 septembre 2024 (point 8), et enfin l'avis de la deuxième chambre civile du 19 décembre 2024 conforme à la solution européenne (point 9).
"La chambre criminelle ne fait ici que reprendre mot pour mot le raisonnement de la CJUE"
La chambre criminelle ne fait ici qu'appliquer, en toute logique, la solution imposée par la primauté du droit de l'Union. Elle reprend mot pour mot le raisonnement de la CJUE en soulignant qu'opposer la nullité au souscripteur-victime "conduirait à priver de tout effet utile les dispositions de la directive 2009/103/CE" et "limiterait de manière disproportionnée le droit de la victime à obtenir une indemnisation" (point 16). L'arrêt illustre parfaitement comment le juge national doit interpréter le droit interne (ici, les effets de la nullité de l'article L. 113-8 du code des assurances) à la lumière des objectifs d'une directive européenne.
II. La portée et les limites du principe d'inopposabilité de la nullité
Si l'arrêt consacre un principe d'inopposabilité très large, il ne supprime pas pour autant la sanction de la fausse déclaration et introduit une limite théorique à son application. La solution réside dans une dualité des sanctions (A) et dans l'exception de l'abus de droit, dont le contrôle est toutefois strict (B).
A. La dualité des conséquences : une nullité maintenue mais à l'efficacité limitée
Il est crucial de noter que la Cour d'appel, dont le raisonnement est validé, a bien prononcé la nullité du contrat d'assurance (point 13). L'arrêt ne remet pas en cause le principe de l'article L. 113-8 du code des assurances. La fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est toujours sanctionnée par la nullité du contrat.
"La fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est toujours sanctionnée par la nullité du contrat."
Toutefois, les effets de cette nullité sont paralysés en ce qui concerne l'indemnisation de la victime. L'assureur doit indemniser M. [B]. La nullité n'est donc pas anéantie, mais déclarée "inopposable". Cela signifie qu'elle conserve potentiellement des effets dans les rapports entre l'assureur et l'assuré fautif. L'assureur, après avoir indemnisé la victime, devrait logiquement conserver la possibilité d'exercer une action récursoire contre son assuré pour récupérer les sommes versées, sur le fondement de la nullité du contrat. L'inopposabilité protège le droit à indemnisation de la victime, mais ne la décharge pas de ses responsabilités en tant que cocontractant fraudeur.
B. L'abus de droit, une exception de principe à l'effectivité contrôlée
La seule limite au principe d'inopposabilité est l'exception d'abus de droit, expressément mentionnée par la CJUE et reprise par la Cour de cassation (points 15 et 18). L'arrêt prend soin de définir cette notion en se référant à une jurisprudence européenne antérieure (arrêt BMW Bank, point 17), exigeant la réunion de deux conditions cumulatives : un élément objectif (l'objectif de la réglementation n'est pas atteint) et un élément subjectif (la volonté de créer artificiellement les conditions pour obtenir un avantage).
"L'arrêt prend soin de définir l'exception d'abus de droit en se référant à une jurisprudence européenne antérieure, exigeant la réunion de deux conditions cumulatives : un élément objectif et un élément subjectif"
Cependant, la Cour écarte immédiatement son application en l'espèce. Elle considère que l'objectif de la directive (protéger les victimes) est précisément atteint lorsque M. [B], en tant que passager, sollicite son indemnisation. Cet automatisme apparent rend la caractérisation de l'abus de droit très difficile dans cette configuration. Pour que l'abus de droit soit retenu, il faudrait imaginer un scénario frauduleux plus complexe, où la victime aurait artificiellement créé les conditions de l'accident ou de son statut de victime dans le but de bénéficier indûment de la protection européenne. En l'état, l'abus de droit apparaît davantage comme un garde-fou théorique que comme une exception fréquemment applicable.