CJUE 1er août 2025: Rectification de la TVA indûment facturée et recours à l’estimation en cas de facturation de masse
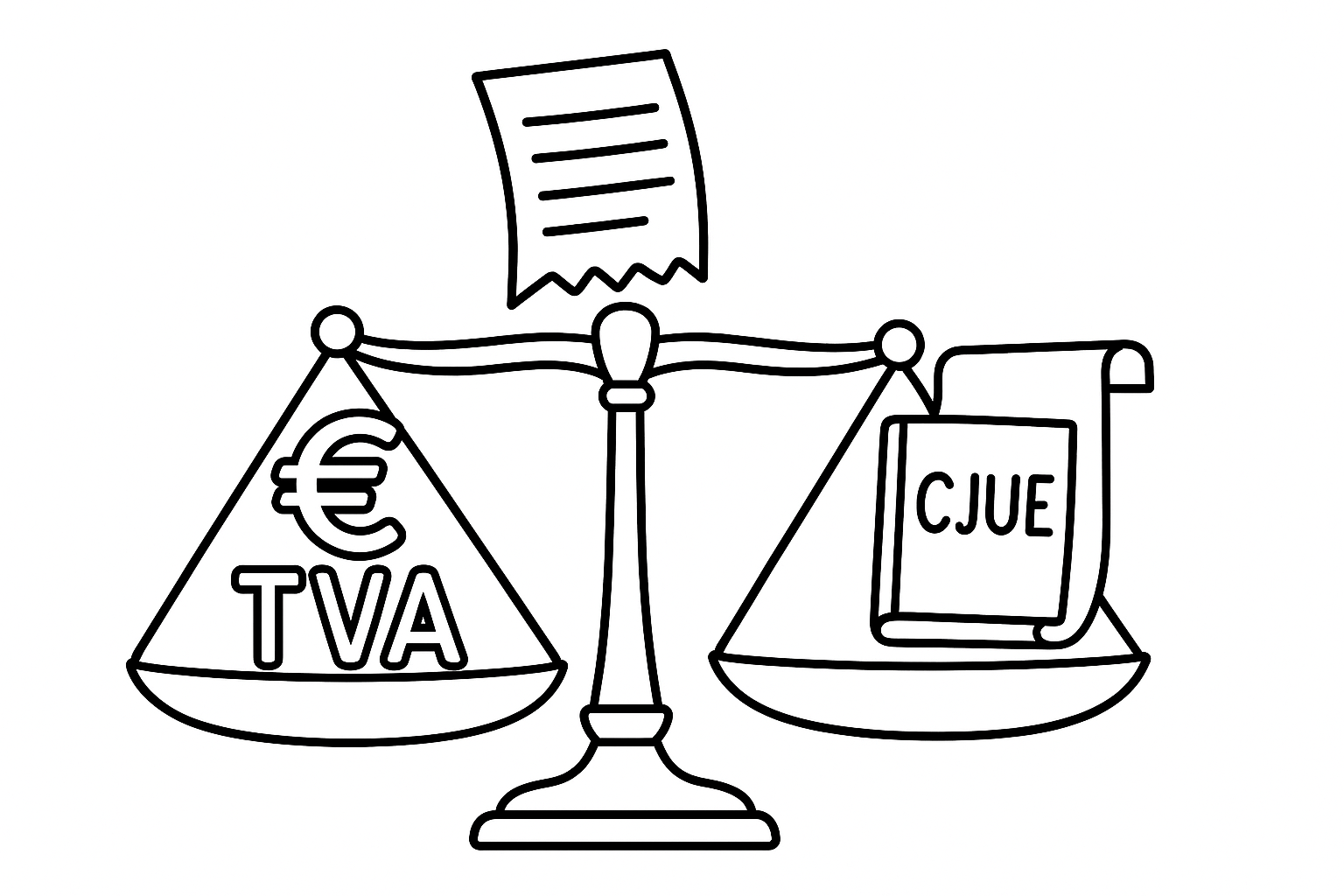
Entre la rigueur du principe selon lequel toute TVA mentionnée sur une facture est due et l'impératif de neutralité fiscale, le droit de la TVA est le théâtre d'une tension constante. C'est précisément cet équilibre délicat que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est venue affiner dans son arrêt du 1er août 2025, en apportant des clarifications cruciales sur les conditions de rectification d'une TVA indûment facturée dans le contexte complexe du commerce de masse.
Faits
Une société autrichienne (P GmbH), exploitant une aire de jeux intérieure, a appliqué par erreur un taux de TVA de 20 % aux droits d'entrée, au lieu du taux réduit de 13 %. Elle a émis à ses clients des tickets de caisse sous le régime de la facturation simplifiée. Ayant constaté son erreur, la société a tenté de rectifier sa déclaration de TVA, ce que l'administration fiscale autrichienne a refusé, arguant de l'impossibilité de corriger les factures et du risque d'enrichissement sans cause pour la société (points 10 et 11).
Procédure
Cette affaire constitue le second renvoi préjudiciel dans le même litige. Un premier arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022 (*Finanzamt Österreich*, C-378/21) avait jugé qu'un assujetti n'est pas redevable de la TVA facturée à tort si ses clients sont *exclusivement* des consommateurs finals sans droit à déduction (point 14). À la suite de cet arrêt, la juridiction autrichienne a tenté d'appliquer cette solution en estimant que le risque de perte de recettes fiscales ne concernait que 0,5 % du chiffre d'affaires, correspondant aux clients potentiellement assujettis (point 16). L'administration fiscale a contesté cette méthode d'estimation, ce qui a conduit le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) à saisir à nouveau la Cour de trois questions préjudicielles (points 17 et 21).
Problème de droit
La Cour était invitée à préciser les conditions d'application de l'exception à la redevabilité de la TVA indûment facturée, prévue à l'article 203 de la directive TVA. Plus spécifiquement, elle devait déterminer si l'exonération de cette dette dépendait d'une analyse facture par facture ou globale ; clarifier la notion de « consommateur final ne bénéficiant pas d’un droit à déduction » ; et enfin, statuer sur la légalité et les modalités du recours à une méthode d'estimation pour déterminer la part des factures présentant un risque de perte de recettes fiscales dans un contexte de facturation simplifiée de masse.
Solution
La Cour de justice répond en trois temps.
1. Elle juge qu'un assujetti n'est pas redevable de la TVA facturée à tort à un non-assujetti, et que cette analyse doit être menée facture par facture, indépendamment du fait que d'autres clients soient des assujettis (point 27).
2. Elle interprète de manière stricte la notion de « consommateur final ne bénéficiant pas d’un droit à déduction », la limitant aux seules « personnes non assujetties » et excluant ainsi les assujettis, même lorsqu'ils agissent à des fins privées (point 32).
3. Elle valide la possibilité de recourir à une estimation pour déterminer la part des factures concernées par le risque de perte fiscale, à condition que cette méthode respecte les principes de neutralité et de proportionnalité, et garantisse les droits de la défense de l'assujetti (point 45).
Portée
Cet arrêt constitue une pièce maîtresse dans l'édifice jurisprudentiel relatif à la rectification de la TVA. Il prolonge et précise la portée de l'arrêt de 2022 en offrant une solution pragmatique aux entreprises du secteur du commerce de masse (B2C). En validant l'estimation comme méthode probatoire, la Cour évite de rendre le droit à rectification purement théorique, tout en encadrant cette pratique par des garde-fous stricts pour protéger les recettes fiscales et les droits des assujettis.
Annonce du plan
Il conviendra d'analyser dans un premier temps la clarification apportée par la Cour quant aux conditions de fond de l'exonération de la dette de TVA (I), avant d'examiner dans un second temps la consécration d'une solution probatoire pragmatique mais exigeante pour les cas de facturation de masse (II).
DÉVELOPPEMENT
I. LA CLARIFICATION DES CONDITIONS D'EXONÉRATION DE LA DETTE DE TVA : UNE APPROCHE ANALYTIQUE ET RESTRICTIVE
La Cour affine sa jurisprudence antérieure en précisant les deux critères fondamentaux qui déterminent si un assujetti peut être dispensé de verser la TVA facturée à tort : l'appréciation du risque doit être menée facture par facture (A) et le destinataire doit être un non-assujetti au sens strict (B).
A. L'affirmation d'une appréciation du risque "facture par facture"
La Cour rappelle que l'objectif de l'article 203 de la directive TVA est d'« éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer le droit à déduction » (point 24). La logique qui sous-tend la redevabilité de la TVA indûment mentionnée est donc entièrement liée à la possibilité pour le destinataire de la facture d'exercer à tort une déduction.
Partant de ce postulat, la Cour en déduit logiquement que l'existence de ce risque « doit être évalué sur la base d’une facture spécifique » (point 26). Elle écarte ainsi une approche globale qui consisterait à considérer que la seule présence de clients assujettis dans la clientèle globale de l'entreprise suffirait à rendre l'assujetti redevable de la totalité de la TVA erronément facturée. La solution est claire : « un assujetti [...] n’est pas redevable de la partie de la TVA qui a été facturée à tort à une personne non assujettie, même si cet assujetti a également fourni des prestations de même nature à d’autres assujettis » (point 27).
Cette approche analytique est une victoire pour le principe de proportionnalité. Elle évite de pénaliser un assujetti au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour protéger les recettes fiscales. Toutefois, elle reporte la difficulté sur le terrain de la preuve, en particulier dans un contexte de commerce de masse où l'identification individuelle des clients est matériellement impossible, ce qui justifie l'analyse de la troisième question préjudicielle.
B. Une définition stricte du "consommateur final" excluant les assujettis
La seconde clarification, et sans doute la plus critique, porte sur la définition du « consommateur final ne bénéficiant pas d’un droit à déduction de la TVA », notion clé de l'arrêt de 2022. La juridiction de renvoi se demandait si un assujetti agissant à des fins privées (et donc sans droit à déduction *in concreto*) pouvait être assimilé à un tel consommateur.
La réponse de la Cour est univoque et restrictive. Elle juge que cette notion doit être interprétée de manière stricte et qu'elle vise « uniquement des personnes non assujetties » (point 32). Les assujettis, même s'ils agissent à des fins privées, sont exclus de cette catégorie. La justification repose sur une appréciation abstraite du risque : tant que le destinataire a la qualité d'assujetti, le risque qu'il utilise la facture pour une déduction « ne saurait être exclu », même si cette déduction serait infondée (point 30). Un risque potentiel, même faible, suffit à maintenir la dette de TVA en application de l'article 203.
Cette interprétation, si elle offre une sécurité juridique maximale aux administrations fiscales, peut paraître sévère. Elle crée une fiction juridique où un risque théorique l'emporte sur l'absence de risque réel de perte de recettes, lorsque l'assujetti destinataire n'a manifestement aucun droit à déduction pour la prestation en cause. Cette position rigide renforce la dichotomie entre assujettis et non-assujettis et complexifie la tâche de l'émetteur de la facture, qui ne peut se contenter de l'usage final de la prestation mais doit s'en tenir au statut fiscal de son client.
II. LA CONSÉCRATION D'UNE SOLUTION PROBATOIRE PRAGMATIQUE : L'ESTIMATION SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Face à l'impossibilité pratique d'une analyse facture par facture dans le commerce de masse, la Cour valide le recours à l'estimation (A), mais l'assortit de conditions strictes pour garantir les principes fondamentaux du droit de l'Union (B).
A. La validation de principe du recours à l'estimation
Reconnaissant que la directive TVA ne régit pas la charge de la preuve dans de telles situations (point 36), la Cour se tourne vers les principes généraux pour résoudre la difficulté. Dans un contexte de « volume des factures [...] très important » et d'identité des destinataires inconnue (point 34), exiger une preuve individuelle rendrait le droit à régularisation « pratiquement impossible », en violation du principe d'effectivité (point 37).
En conséquence, la Cour juge que la directive TVA « ne s’oppose pas à ce que [...] une administration fiscale ou une juridiction nationale puisse recourir à une estimation » (point 45). Cette validation est une avancée pragmatique majeure. Elle offre un outil concret pour résoudre les litiges où la rigueur de la preuve individuelle conduirait à une impasse et à une violation du principe de neutralité. La Cour légitime ainsi une pratique que les juridictions nationales, comme en l'espèce, commençaient à explorer, offrant un cadre juridique européen à cette nécessité pratique.
B. L'encadrement strict de la méthode par les principes de neutralité, proportionnalité et des droits de la défense
Cette validation n'est cependant pas un chèque en blanc. La Cour encadre l'usage de l'estimation par trois garanties fondamentales.
Premièrement, l'estimation doit reposer sur des critères objectifs et pertinents. Elle doit prendre en compte « toutes les circonstances pertinentes, telles que la nature du service fourni, les modalités de prestation et de facturation [...], ainsi que toute information statistique sur les destinataires » (point 39). Les données utilisées doivent être « exactes, fiables et à jour » (point 43).
Deuxièmement, l'estimation doit respecter le principe de proportionnalité et le droit à la défense. Elle ne peut donner naissance qu'à une « présomption réfragable » (point 43). L'assujetti doit être mis en mesure de « faire connaître utilement son point de vue » et de « contester l’exactitude de l’estimation » (point 44). De manière cruciale, le niveau de preuve requis pour renverser cette présomption ne doit pas être « excessivement élevé » (point 44).
Enfin, le principe de neutralité fiscale demeure la clé de voûte. Le système doit permettre de « soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA » (point 41). L'estimation ne doit pas aboutir à laisser à la charge de l'assujetti une TVA dont il est en droit d'obtenir le remboursement.
Cet encadrement strict, tout en étant protecteur des droits de l'assujetti, déplace le contentieux du "si" vers le "comment". Le débat portera désormais sur la fiabilité des données, la pertinence des méthodes statistiques et le caractère "raisonnable" de la charge de la preuve pour l'assujetti, ouvrant la voie à de nouveaux défis pour les praticiens et les juges.
CONCLUSION
Par son arrêt du 1er août 2025, la Cour de justice de l'Union européenne accomplit un exercice d'équilibriste remarquable. Elle réaffirme la finalité de l'article 203 de la directive TVA – la lutte contre le risque de perte de recettes fiscales – tout en adaptant son application aux réalités du commerce moderne. En combinant une interprétation stricte des conditions de fond (analyse par facture, définition restrictive du consommateur final) avec une approche probatoire pragmatique (validation de l'estimation), elle dessine une voie de résolution pour des litiges qui semblaient insolubles. L'assujetti gagne un droit à l'estimation, mais hérite d'une charge probatoire exigeante pour en contester les résultats.
Ouverture
Cet arrêt, en validant une méthode de "réparation" a posteriori aussi complexe que l'estimation, ne sonne-t-il pas le glas des régimes de facturation simplifiée actuels ? En soulignant les difficultés insurmontables liées à l'anonymat des clients et au manque de données, la Cour met indirectement en lumière l'inadéquation de ces systèmes face aux exigences de la fiscalité moderne. La véritable provocation de cette décision réside dans son invitation implicite à accélérer la transition vers une fiscalité numérique intégrale (facturation électronique obligatoire, transmission de données en temps réel) où le statut du client et le taux applicable seraient vérifiés en amont. Cet arrêt pourrait alors être vu non comme une fin en soi, mais comme la chronique d'une obsolescence annoncée, poussant les États membres à choisir entre la complexité des contentieux de l'estimation et la simplicité d'un contrôle fiscal numérisé.