Conditions de qualification des BNC : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 octobre 2025, n°23PA05275
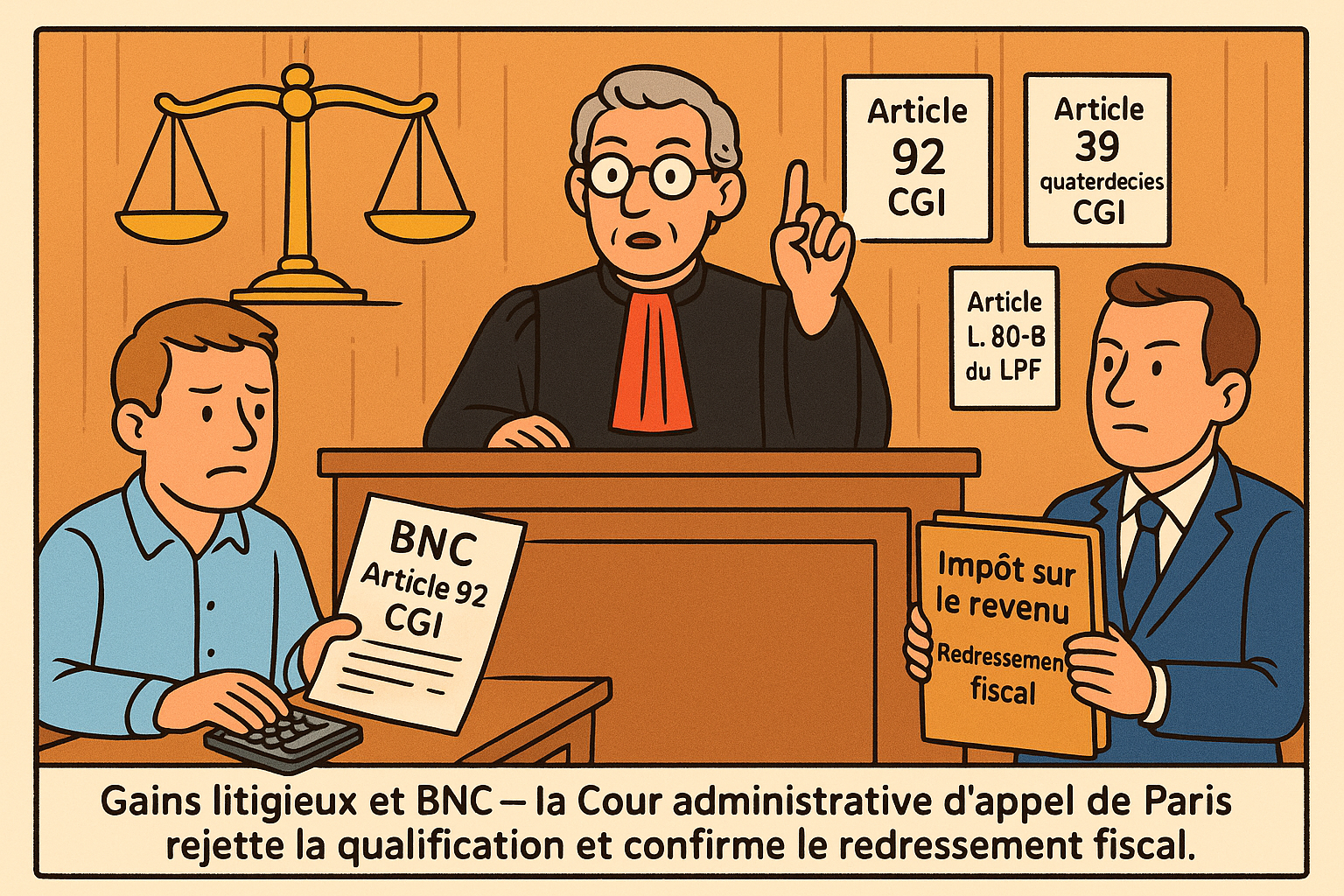
I. Rappel des faits
Un contribuable personne physique a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses revenus des années 2016 à 2018. À l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, le 22 novembre 2019, une proposition de rectification entraînant des suppléments d'impôt sur le revenu. Le litige porte sur la qualification fiscale de gains réalisés par le contribuable, que l'administration n'a pas considérés comme des bénéfices non commerciaux (BNC).
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
- Procédure antérieure : Le contribuable a formulé plusieurs réclamations, qui ont été partiellement admises puis rejetées. Il a ensuite saisi le Tribunal administratif de Paris, qui, par un jugement du 30 octobre 2023, a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires. Le contribuable a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Paris.
- Prétentions du requérant (le contribuable) : Il soutient que les gains en cause relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) au sens de l'article 92 du Code général des impôts (CGI). Cette qualification lui permettrait de bénéficier du mécanisme d'étalement sur trois ans de la plus-value nette à court terme, prévu par l'article 39 quaterdecies du CGI. Subsidiairement, il se prévaut de la garantie contre les changements de doctrine administrative, prévue à l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales (LPF).
- Prétentions du défendeur (l'administration fiscale) : L'administration soutient que les revenus ne peuvent être qualifiés de BNC et que, par conséquent, le régime d'étalement est inapplicable.
III. Thèse du requérant rejetée par la Cour
La thèse du requérant consiste à affirmer que les gains litigieux, issus d'une "occupation lucrative", doivent être qualifiés de BNC. Cette qualification est pour lui la condition nécessaire à l'application du régime d'étalement prévu à l'article 39 quaterdecies du CGI, qui lui permettrait de lisser l'imposition d'une plus-value exceptionnelle.
IV. Problème de droit
Des gains réalisés par une personne physique dans le cadre d'une activité lucrative peuvent-ils être qualifiés de bénéfices non commerciaux (BNC) au sens de l'article 92 du CGI, ouvrant ainsi droit au mécanisme d'étalement de l'imposition prévu à l'article 39 quaterdecies du même code ?
V. Réponse de la Cour
La Cour administrative d'appel confirme le jugement du Tribunal administratif et rejette la requête du contribuable.
La Cour juge que les gains ne remplissent pas les conditions pour être qualifiés de BNC et/ou que le mécanisme d'étalement de l'article 39 quaterdecies du CGI n'est pas applicable dans les circonstances de l'espèce. Elle écarte également l'application de la garantie prévue à l'article L. 80 B du LPF.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 16 octobre 2025 s'inscrit dans le contentieux classique de la qualification des revenus, dont dépend l'application de régimes fiscaux dérogatoires. En confirmant le rejet de la demande du contribuable, la Cour rappelle la stricte application des critères de qualification d'une part, et l'interprétation rigoureuse des garanties procédurales d'autre part. Le présent arrêt illustre ainsi la double difficulté pour le contribuable de faire admettre une qualification fiscale avantageuse face à l'administration (I), tout en se heurtant à l'efficacité limitée des garanties qu'il invoque pour contester la procédure (II).
I. La qualification contestée des revenus, obstacle à l'optimisation fiscale
La décision de la Cour repose sur une analyse stricte de la nature des revenus, refusant au contribuable le bénéfice d'un régime d'étalement en raison d'une qualification inadaptée (A) et de l'inapplicabilité du dispositif sollicité (B).
A. La qualification en BNC subordonnée à la caractérisation d'une occupation lucrative
Le cœur du litige réside dans la qualification des gains en bénéfices non commerciaux (BNC) au sens de l'article 92 du CGI. Pour le requérant, cette qualification est essentielle. La jurisprudence récente montre que le juge de l'impôt examine avec soin les conditions factuelles de l'activité. Par exemple, pour des gains de jeu, le Conseil d'État exige que le contribuable démontre une pratique habituelle lui permettant de "maîtriser de façon significative l'aléa" et de percevoir des "revenus significatifs" pour que l'activité soit qualifiée d'occupation lucrative imposable en BNC (Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21/06/2018, 412124).
" la qualification en BNC des rémunérations d'un dirigeant de société a été admise uniquement en l'absence de tout lien de subordination"
De même, la qualification en BNC des rémunérations d'un dirigeant de société a été admise uniquement en l'absence de tout lien de subordination (Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08/12/2017, 409429). En l'espèce, il est probable que le requérant n'ait pas réussi à prouver que son activité dépassait la simple gestion de son patrimoine privé pour constituer une véritable occupation professionnelle ou une source de profits répondant à ces critères exigeants, ce qui a conduit la Cour à écarter la qualification de BNC.
B. Le refus d'appliquer le mécanisme d'étalement des plus-values
Conséquence directe du refus de la qualification en BNC, la Cour écarte l'application de l'article 39 quaterdecies du CGI. Ce texte permet, sous conditions, d'étaler sur trois ans l'imposition des plus-values nettes à court terme. Or, ce dispositif est historiquement lié à l'imposition des bénéfices professionnels (BIC, BA et BNC). En jugeant que les revenus en cause ne constituaient pas des BNC, la Cour a logiquement conclu à l'impossibilité d'appliquer un régime d'étalement qui leur est attaché.
"Le juge refuse ainsi d'étendre un mécanisme d'étalement prévu pour une catégorie de revenus spécifique à des gains qui n'en relèvent pas"
Cette solution s'inscrit dans une logique d'interprétation stricte des textes fiscaux, particulièrement lorsqu'ils prévoient un avantage pour le contribuable. Le juge refuse ainsi d'étendre un mécanisme d'étalement prévu pour une catégorie de revenus spécifique à des gains qui n'en relèvent pas, soulignant l'importance de la qualification initiale du revenu pour déterminer le régime d'imposition applicable (Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421444, Publié au recueil Lebon), où le Conseil d'État avait déjà sanctionné une cour d'appel pour ne pas avoir suffisamment caractérisé la nature d'un gain avant de le qualifier.
II. L'efficacité limitée des garanties invoquées par le contribuable
Outre le débat sur la qualification, le requérant a tenté de s'appuyer sur des garanties procédurales. Cependant, la décision de la Cour illustre que ni la garantie doctrinale (A) ni les règles générales de procédure (B) ne lui ont été d'un grand secours.
A. L'échec de l'invocation de la doctrine administrative
Le requérant invoquait l'article L. 80 B du LPF, qui permet à un contribuable de se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration sur sa situation. Pour que cette garantie s'applique, les conditions sont très strictes : il doit exister une prise de position explicite, préalable, et portant sur la situation de fait précise du contribuable. Il est fort probable que le requérant n'ait pas pu produire un tel document. La jurisprudence est constante sur l'appréciation rigoureuse des conditions d'application des garanties doctrinales. Par analogie, pour l'article L. 80 A du LPF, le Conseil d'État a jugé que l'interprétation administrative invocable est celle en vigueur à la date du fait générateur de l'imposition (Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10/02/2017, 386221). En l'espèce, l'absence d'une prise de position formelle et directement applicable à la situation du requérant a sans doute conduit la Cour à écarter, sans surprise, le bénéfice de cette garantie.
B. La charge de la preuve et la régularité du contrôle sur pièces
L'arrêt, en confirmant le rejet, souligne implicitement que le contribuable n'a pas réussi à renverser la charge de la preuve qui lui incombait après la réception d'une proposition de rectification dûment motivée. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, la procédure est moins formaliste qu'une vérification de comptabilité, mais l'administration reste tenue à des obligations, comme celle de fonder ses rectifications sur des éléments concrets.
"Le rejet de la requête suggère que la proposition de rectification était suffisamment motivée en fait et en droit"
La jurisprudence rappelle que l'administration doit étayer sa contestation (Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/06/2020, 425789) et informer le contribuable de l'origine des renseignements obtenus de tiers (Cour de cassation - 20 septembre 2023 - 21-24.081). Le rejet de la requête suggère que la proposition de rectification était suffisamment motivée en fait et en droit, et que le contribuable n'a pas apporté de preuves contraires suffisantes pour démontrer le caractère non fondé des redressements ou une irrégularité dans la procédure suivie par l'administration. La décision finale repose donc classiquement sur l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond.