Contentieux fiscal : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 8 octobre 2025, Pourvoi n° 24-16.995
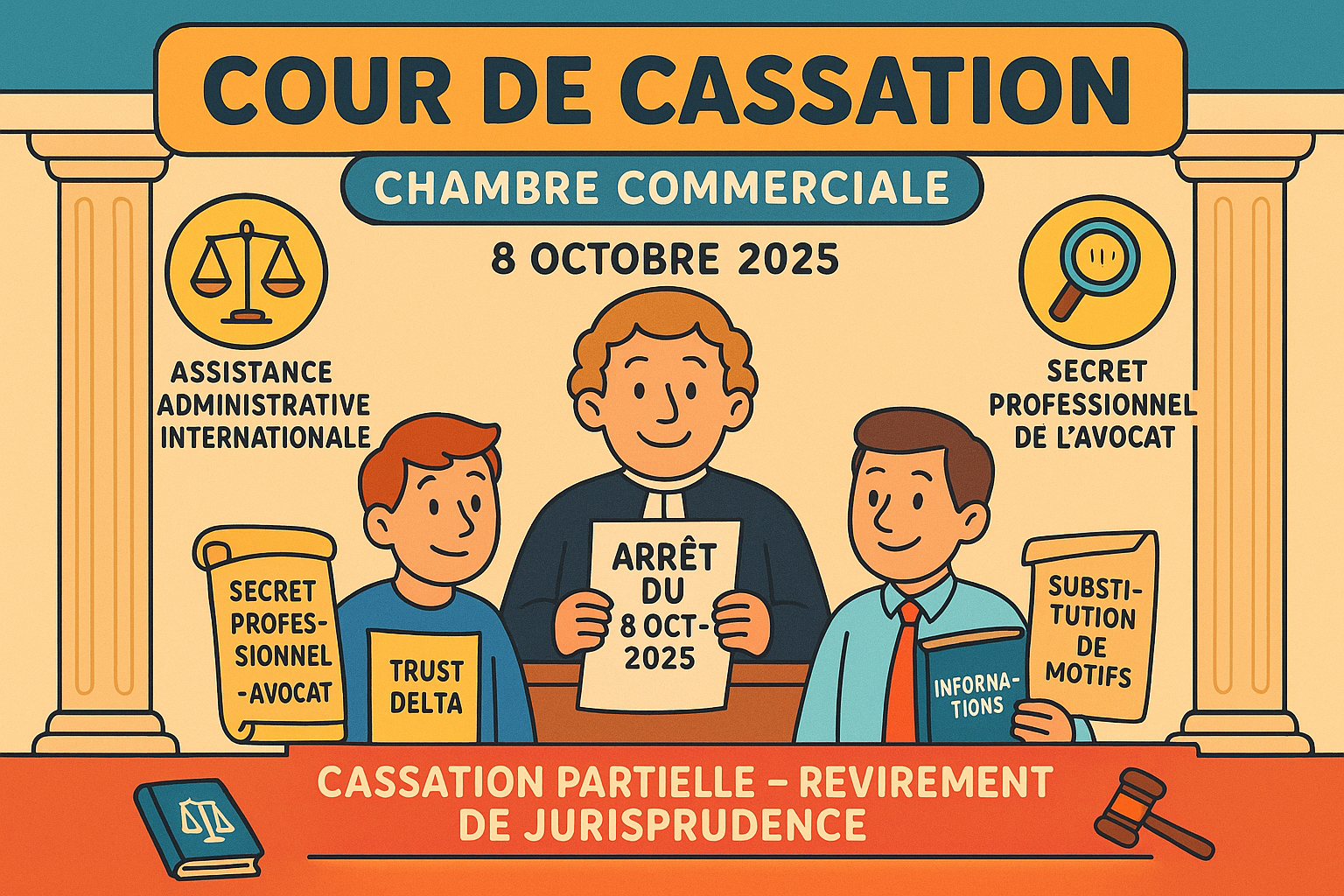
I. Rappel des faits
Un contentieux fiscal est né à la suite du décès d’une personne en 2001, dont le domicile fiscal était en France. La succession comprenait notamment des biens placés dans un trust de droit étranger (le "Delta Trust") et des parts d’une SCI.
En 2011, l’administration fiscale a notifié une proposition de rectification aux héritiers concernant les droits de mutation à titre gratuit, réintégrant dans l’actif successoral les biens logés dans le trust. Cette démarche a été suivie d’une mise en demeure pour défaut de déclaration.
II. Etapes de la procédure et prétentions des parties
L'affaire a donné lieu à une longue procédure judiciaire (TGI en 2019, Cour d’appel en 2024).
L’héritier (demandeur au pourvoi principal) contestait les redressements en soulevant plusieurs moyens :
- La prescription du droit de reprise de l’administration fiscale.
- L'irrégularité de la procédure d’imposition, arguant que des informations avaient été obtenues en violation des conventions fiscales internationales.
- La violation du secret professionnel de l’avocat, l'administration s'étant fondée sur une pièce qui en était couverte sans l'accord du client.
- Le caractère irrévocable du dessaisissement du défunt au profit du trust, ce qui devait exclure les biens de l’actif successoral.
L’administration fiscale (demanderesse au pourvoi incident) soutenait la validité des redressements et de la procédure de taxation d’office en raison de la défaillance déclarative de l’héritier. Elle arguait notamment que le défunt n'avait pas perdu le contrôle effectif des biens placés dans le trust et demandait la confirmation des impositions, y compris par substitution de motifs en cours d'instance.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d’appel (2024) avait validé en partie les redressements de l’administration. Concernant la procédure, elle avait notamment :
1. Jugé que des bilans de société obtenus auprès des autorités irlandaises étaient des pièces valables, sans rechercher si la demande d'information avait été formulée dans le respect de la finalité prévue par la convention fiscale franco-irlandaise.
2. Écarté l'argument tiré de la violation du secret professionnel de l'avocat sans vérifier au préalable si l'expéditeur de la pièce litigieuse avait bien la qualité d'avocat.
3. Ordonné la production de documents sans qu'une partie n'en ait formulé la demande, en méconnaissance des règles procédurales.
IV. Problèmes de droit
La Cour de cassation était saisie de plusieurs questions :
1. Le juge du fond peut-il valider l'utilisation par l'administration fiscale d'informations obtenues par assistance administrative internationale sans vérifier que la demande respectait la finalité restrictive prévue par la convention applicable ?
2. L'administration fiscale peut-elle se fonder sur une pièce potentiellement couverte par le secret professionnel de l'avocat, et le juge peut-il écarter ce moyen sans vérifier la qualité de l'auteur du document ?
3. Le juge peut-il enjoindre d'office la production de pièces en l'absence de demande d'une partie ?
V. Réponse donnée par la Cour de cassation
La Cour de cassation rend un arrêt de cassation partielle.
Elle censure la décision de la cour d'appel sur plusieurs points, en se fondant sur les visas suivants :
- Visa : Articles 1er et 23 § 1 de la convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968. La Cour juge que la cour d'appel aurait dû rechercher si les informations obtenues auprès des autorités irlandaises avaient été demandées "pour les besoins de l'établissement et du recouvrement des impôts visés par cette Convention". Faute de cette vérification, la décision est privée de base légale.
- Visa : Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. La Cour rappelle que le secret professionnel de l'avocat est une garantie fondamentale. L'administration ne peut se fonder sur une pièce couverte par ce secret sans l'accord du client. La cour d'appel ne pouvait donc écarter ce moyen sans vérifier si l’expéditeur de la pièce était bien avocat.
- Visa : Article 11, alinéa 2, du Code de procédure civile. La Cour sanctionne l'initiative du juge d'appel qui a ordonné la production forcée de documents sans qu'une partie ne l'ait sollicité, méconnaissant ainsi les conditions d'application de ce texte.
Par ailleurs, dans un obiter dictum de grande portée, la Cour opère un revirement de jurisprudence en affirmant que l'administration peut désormais, "à tout moment de l'instance, y compris pour la première fois en appel", demander au juge de retenir un motif autre que celui de la proposition de rectification, à condition de respecter le débat contradictoire.
Commentaire d'arrêt
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 octobre 2025, dans une formation solennelle de section, revêt une importance particulière. Au-delà de la résolution d'un complexe contentieux successoral international impliquant un trust, cette décision clarifie de manière significative les garanties procédurales du contribuable (I), tout en opérant un revirement de jurisprudence notable qui étend les prérogatives de l'administration devant le juge de l'impôt (II).
I. Le renforcement des garanties procédurales face à l'assistance administrative internationale
La Cour de cassation profite de cette affaire pour réaffirmer avec force deux garanties fondamentales du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal : le respect scrupuleux des conventions internationales (A) et la protection intangible du secret professionnel de l'avocat (B).
A. Le contrôle strict de la finalité des demandes d’informations conventionnelles
"Cette solution impose au juge de l'impôt un contrôle concret et non purement formel de la régularité de l'obtention de la preuve."
La cassation est principalement prononcée pour un manquement de la cour d'appel à son office de contrôle. En censurant les juges du fond pour ne pas avoir recherché si les bilans obtenus auprès des autorités irlandaises l'avaient été "pour les besoins de l'établissement et du recouvrement des impôts visés" par la convention franco-irlandaise, la Cour de cassation envoie un signal clair : l'assistance administrative internationale n'est pas un chèque en blanc.
Cette solution impose au juge de l'impôt un contrôle concret et non purement formel de la régularité de l'obtention de la preuve. Il ne suffit pas que l'information provienne d'un État partenaire ; il faut que la demande initiale de l'administration française s'inscrive dans le champ matériel et la finalité stricte définis par la convention. Ce faisant, la Cour protège le contribuable contre d'éventuelles "pêches aux informations" qui outrepasseraient le cadre légal négocié entre les États. Cette exigence de rigueur s'applique également à d'autres instruments, comme l'accord avec les Îles Caïmans, dont la Cour précise le champ d'application temporel et matériel pour les affaires pénales fiscales.
B. La protection réaffirmée du secret professionnel et des droits de la défense
La deuxième branche de la cassation, fondée sur l'article 66-5 de la loi de 1971, confirme le statut de bastion du secret professionnel de l'avocat. En reprochant à la cour d'appel d'avoir balayé l'argument sans même vérifier la qualité d'avocat de l'auteur du document litigieux, la Cour réitère un principe constant : toute pièce couverte par ce secret est inexploitable par l'administration, sauf accord exprès du client (CE, 28 février 2025, 486336, CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 08/02/2022, 20VE01230, Inédit au recueil Lebon). Cette solution s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle forte, partagée avec le Conseil d'État, qui considère ce secret comme une garantie essentielle des droits de la défense (CE, 20 mai 2025, 475782, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/02/2025, 486336).
La censure additionnelle sur le fondement de l'article 11 du Code de procédure civile, qui interdit au juge d'ordonner d'office la production de pièces, complète ce tableau. La Cour rappelle que les règles du procès civil s'appliquent pleinement au contentieux fiscal et que le juge ne peut se substituer aux parties dans l'administration de la preuve. Ces deux cassations, combinées, renforcent la prévisibilité et la sécurité juridique du procès fiscal.
II. La clarification du régime des trusts et l'extension des pouvoirs du juge
Si l'arrêt est protecteur des garanties procédurales, il n'en est pas moins pragmatique sur le fond, en confirmant une approche économique du trust (A) et en consacrant une nouvelle prérogative procédurale au profit de l'administration (B).
A. La confirmation du critère du dessaisissement effectif pour l'imposition du trust
Sur le fond du droit fiscal des trusts, l'arrêt s'inscrit dans la continuité. Il rappelle que la question centrale est de savoir si le constituant s'est "irrévocablement et effectivement dessaisi" des biens. Pour ce faire, le juge doit procéder à une analyse du "fonctionnement concret du trust", en examinant les prérogatives réelles conservées par le constituant, plutôt que de s'arrêter à la qualification juridique formelle de l'acte de trust.
"L'enjeu pour le juge n'est pas de valider le trust au regard de sa loi étrangère, mais d'en tirer les conséquences fiscales en droit français"
Cette approche factuelle, déjà affirmée en matière pénale (Cour de cassation - 06 janvier 2021 - 18-84.570) et pour l'ISF (Cour de cassation, arret, 2009-03-31, 07-20.219), est ici confirmée pour les droits de mutation à titre gratuit. L'enjeu pour le juge n'est pas de valider le trust au regard de sa loi étrangère, mais d'en tirer les conséquences fiscales en droit français. Les biens restent dans le patrimoine taxable du défunt si, en dépit de la structure, il en a conservé la maîtrise. Cette solution réaliste vise à prévenir toute évasion fiscale par l'interposition d'un trust de pure façade.
B. Un revirement majeur : la consécration de la substitution de motifs en cours d'instance
L'apport le plus spectaculaire de l'arrêt réside sans doute dans son revirement de jurisprudence sur la substitution de motifs. La Cour de cassation autorise désormais l'administration fiscale à "demander au juge, à tout moment de l'instance, y compris pour la première fois en appel, de retenir un motif autre que celui indiqué dans la proposition de rectification".
"La seule condition posée est le respect du principe du contradictoire"
Cette solution, d'une portée pratique considérable, rompt avec une conception plus formaliste qui exigeait une nouvelle notification pour tout changement de fondement juridique. La seule condition posée est le respect du principe du contradictoire, le contribuable devant être mis en mesure de débattre de ce nouveau motif. Si cette flexibilité accrue accordée à l'administration peut être vue comme un rééquilibrage en faveur de l'efficacité du recouvrement, elle renforce aussi le rôle du juge, qui devient l'arbitre central de la requalification en cours de procès. Pour les praticiens, cette évolution impose une vigilance renouvelée, les débats devant le juge du fond pouvant désormais porter sur des fondements non évoqués dans la procédure administrative initiale.