Fiscalité : Arrêt du Tribunal administratif de Montreuil, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2215574
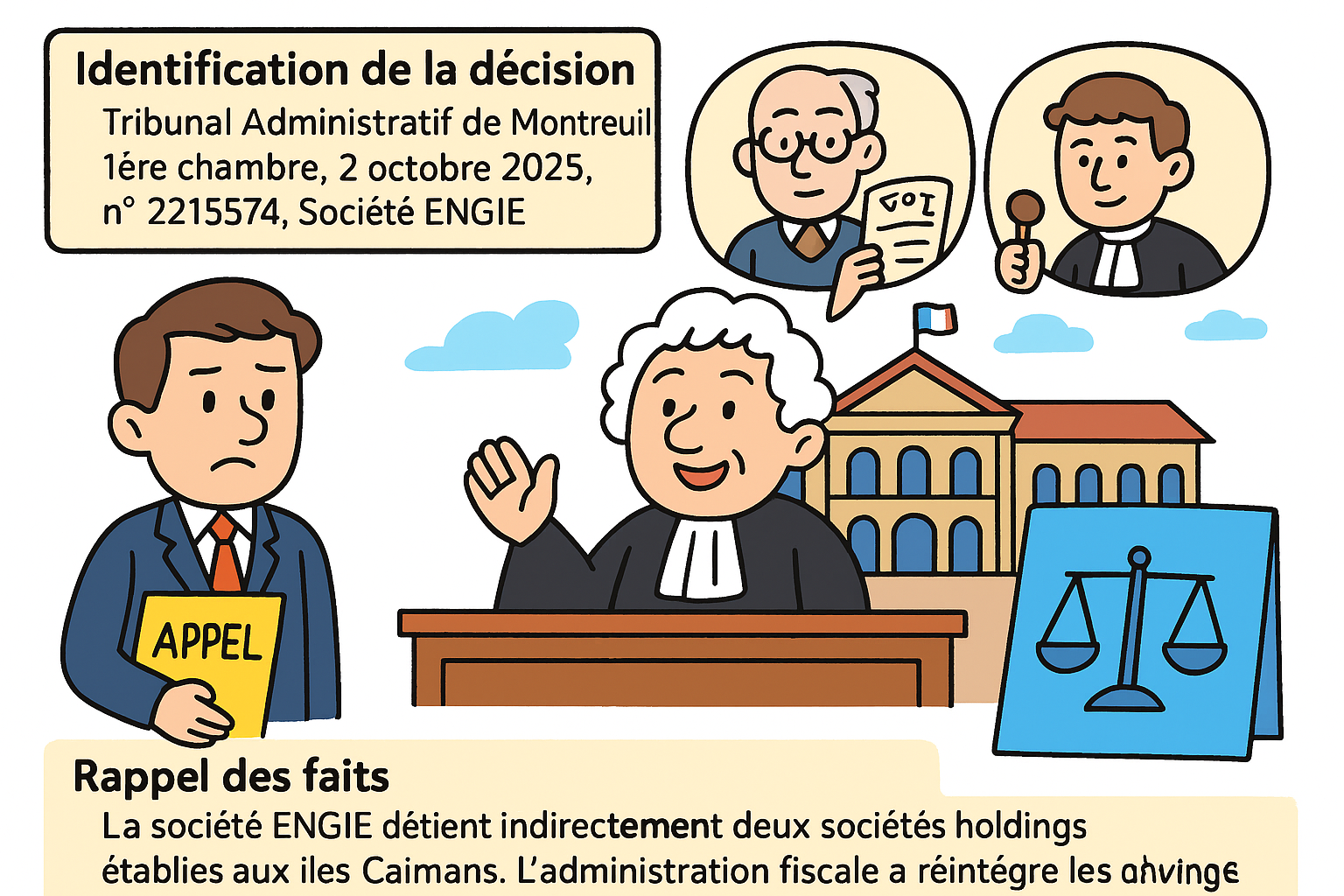
I. Rappel des faits
La société ENGIE, tête d'un groupe fiscalement intégré, détient indirectement deux sociétés holdings, UPLHC I et UPLHC II, établies aux îles Caïmans. Ces holdings perçoivent des dividendes provenant d’une filiale pakistanaise.
À la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2018 et 2019, l'administration fiscale a, sur le fondement de l’article 209 B du Code général des impôts (CGI), réintégré ces dividendes dans le résultat fiscal d'ensemble de la société ENGIE et a remis en cause une partie de ses déficits reportables.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
- Prétentions de la société requérante (ENGIE) : Saisi par des réclamations contentieuses de fin 2021, le tribunal administratif était invité par la société ENGIE à annuler les rectifications. La société soutenait principalement que le régime fiscal des îles Caïmans n'était pas "privilégié" au sens de l’article 238 A du CGI. À titre subsidiaire, elle invoquait le bénéfice de la clause de sauvegarde prévue au III de l’article 209 B du CGI, arguant que la localisation de ses filiales n’avait pas pour objet principal l’évasion fiscale. La société demandait également la correction d'erreurs qu'elle aurait elle-même commises.
- Prétentions de l’administration fiscale (défendeur) : L'administration, après avoir émis les propositions de rectification, a défendu le bien-fondé des impositions. En cours d'instance, par une décision du 30 octobre 2023, elle a toutefois procédé à un dégrèvement partiel en rétablissant une partie des déficits initialement remis en cause.
III. Présentation de la thèse opposée à celle du Tribunal
La thèse de la société ENGIE, rejetée par le tribunal, consistait à soutenir que les conditions d'application de l'article 209 B du CGI n'étaient pas réunies. D'une part, elle contestait la qualification de "régime fiscal privilégié" appliquée aux îles Caïmans, se fondant sur une méthode de comparaison globale du taux d'imposition. D'autre part, elle affirmait que, même si le régime était considéré comme privilégié, la clause de sauvegarde devait s'appliquer car l'établissement des holdings ne procédait pas d'une intention d'évasion fiscale, mais d'autres logiques économiques.
IV. Problème de droit
Le tribunal devait déterminer si les dividendes perçus par des sociétés holdings établies aux îles Caïmans, et dont l'activité se limite à la perception de revenus financiers, doivent être réintégrés dans le résultat fiscal de leur société mère française en application de l'article 209 B du CGI.
Plus précisément, il s'agissait de savoir :
1. Si le régime fiscal des îles Caïmans peut être qualifié de "privilégié" au sens de l'article 238 A du CGI pour l'application du dispositif anti-abus.
2. Si une société holding dont l'activité n'est ni industrielle ni commerciale peut bénéficier de la clause de sauvegarde prévue au III de l'article 209 B en démontrant une absence d'intention principalement fiscale dans sa localisation.
V. Réponse du Tribunal
- Fondements juridiques : Le jugement est rendu au vu, notamment, du Code général des impôts (articles 209 B, 223 A et suivants, 238 A), du Livre des procédures fiscales (article L. 190) et du Code de justice administrative.
- Réponse : Le Tribunal administratif de Montreuil valide l'approche de l'administration fiscale. En rejetant les arguments de la société ENGIE, il juge que les conditions d'application de l'article 209 B du CGI sont remplies. Implicitement, il confirme que le régime fiscal des îles Caïmans est bien "privilégié" et, surtout, il écarte le bénéfice de la clause de sauvegarde, considérant que la société n'a pas apporté la preuve requise par la loi pour en bénéficier. Le tribunal a également déclaré une partie des demandes de la société irrecevables.
Commentaire d'arrêt
Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 2 octobre 2025 offre une illustration pédagogique de l’application du dispositif anti-évasion de l’article 209 B du CGI. En validant le redressement opéré à l’encontre de la société ENGIE, le tribunal confirme l’interprétation stricte des conditions d’application de ce mécanisme, tant sur le fond que sur la procédure. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle rigoureuse visant à concilier la lutte contre l'optimisation fiscale agressive et le respect des libertés économiques.
Le jugement conforte ainsi une application rigoureuse du mécanisme de l’article 209 B (I), tout en s’inscrivant dans le cadre d’un contrôle judiciaire renforcé sur la mise en œuvre des dispositifs anti-abus (II).
I. L’application rigoureuse du mécanisme anti-abus de l’article 209 B du CGI
La décision du tribunal repose sur une double analyse classique mais inflexible : la qualification du régime fiscal étranger (A) et l’appréciation restrictive des conditions de la clause de sauvegarde (B).
A. La qualification confirmée du régime fiscal privilégié
Pour que le dispositif de l’article 209 B s’applique, l’administration doit d'abord établir que l'entité étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié (Conseil d'Etat, Décision, 2022-04-25, 439859). La charge de cette preuve lui incombe (Conseil d'Etat, Décision, 2023-12-12, 464874). En l'espèce, bien que la société ENGIE ait contesté cette qualification pour les îles Caïmans, le tribunal a validé l'analyse de l'administration.
"l’administration doit d'abord établir que l'entité étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié"
Cette décision rappelle que la simple affirmation par le contribuable d'une absence de régime privilégié, fondée sur une méthode de calcul alternative, est insuffisante face aux éléments circonstanciés apportés par l'administration sur le traitement fiscal effectif local (Conseil d'Etat, Décision, 2023-12-12, 464874). En rejetant l'argumentaire d'ENGIE, le tribunal confirme que la qualification de régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI s'apprécie objectivement, au regard d'une imposition nettement inférieure à celle qui serait due en France.
B. L’interprétation restrictive de la clause de sauvegarde
Le cœur du litige et l'apport principal de la décision résident dans le refus d'appliquer la clause de sauvegarde du III de l'article 209 B. Cette clause permet au contribuable d'échapper à l'imposition s'il prouve que la localisation de sa filiale n'a pas pour objet principal l'évasion fiscale. Cette preuve est réputée apportée si la filiale exerce une activité industrielle ou commerciale effective, principalement sur son marché local (Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362002, Inédit au recueil Lebon, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2013, 352716, Inédit au recueil Lebon).
Le tribunal, en retenant le "défaut de démonstration" de la société, applique à la lettre cette condition. Les holdings UPLHC I et II, dont l'activité se limitait à percevoir des dividendes d'une filiale pakistanaise, ne pouvaient manifestement pas se prévaloir d'une "activité industrielle ou commerciale effective" aux îles Caïmans. La jurisprudence interprète ces notions de manière stricte (Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362002, Inédit au recueil Lebon). Le jugement illustre ainsi qu'une simple activité de holding financière, dépourvue de substance économique locale, ne permet pas de bénéficier de cette clause dérogatoire, peu important les motivations non fiscales qui auraient pu, par ailleurs, exister.
II. Le contrôle judiciaire renforcé sur la mise en œuvre des dispositifs anti-abus
Au-delà du fond, la décision met en lumière le rôle du juge dans le contrôle des dispositifs anti-abus, tant sur le plan procédural (A) que dans le respect des principes supérieurs du droit de l'Union européenne (B).
A. La rigueur procédurale, condition de la recevabilité de la contestation
Le jugement ne se limite pas au fond, puisqu'il déclare une partie des conclusions d'ENGIE "irrecevables". Cette irrecevabilité est probablement liée à la nature des demandes, notamment celles visant à faire corriger par le juge une erreur que la société aurait elle-même commise. La jurisprudence récente encadre strictement la recevabilité des réclamations sur le fondement de l'article L. 190 du LPF. Les demandes qui ne visent pas directement la décharge ou la réduction d'une imposition peuvent être requalifiées en recours pour excès de pouvoir, avec des contraintes de recevabilité spécifiques (Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/03/2025, 474164, CE, 13 mars 2025, 474164).
"Les demandes qui ne visent pas directement la décharge ou la réduction d'une imposition peuvent être requalifiées en recours pour excès de pouvoir"
Cette décision rappelle aux contribuables que le contentieux fiscal obéit à un formalisme strict et que toutes les demandes ne relèvent pas du recours de plein contentieux, limitant ainsi la capacité du juge à se substituer au contribuable pour corriger ses propres déclarations hors du cadre prévu.
B. La compatibilité nécessaire avec le droit de l’Union européenne
Bien que le jugement ne le mentionne pas explicitement, son raisonnement s'inscrit dans le cadre défini par la jurisprudence européenne et nationale sur la liberté d'établissement. L'article 209 B n'est compatible avec cette liberté que s'il cible des "montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique" (Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 04/07/2014, 357264, Publié au recueil Lebon). Il ne peut s'appliquer à des sociétés ayant une implantation réelle et une activité économique effective, même non principale (Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 04/07/2014, 357264, Publié au recueil Lebon).
En l'espèce, la structure mise en place par ENGIE (des holdings aux îles Caïmans percevant passivement des dividendes) correspond précisément à la définition du "montage purement artificiel" que le dispositif 209 B a vocation à contrer. La décision du tribunal, en appliquant le texte sans retenir la clause de sauvegarde, opère donc une qualification implicite de la structure comme étant artificielle. Ce faisant, elle respecte la ligne de partage tracée par le droit de l'Union : la lutte contre l'évasion fiscale via des dispositifs nationaux est légitime dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à de véritables activités économiques au sein de l'Union ou, comme ici, dans des États tiers.