Heures supplémentaires : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2025, n° 23-19.055
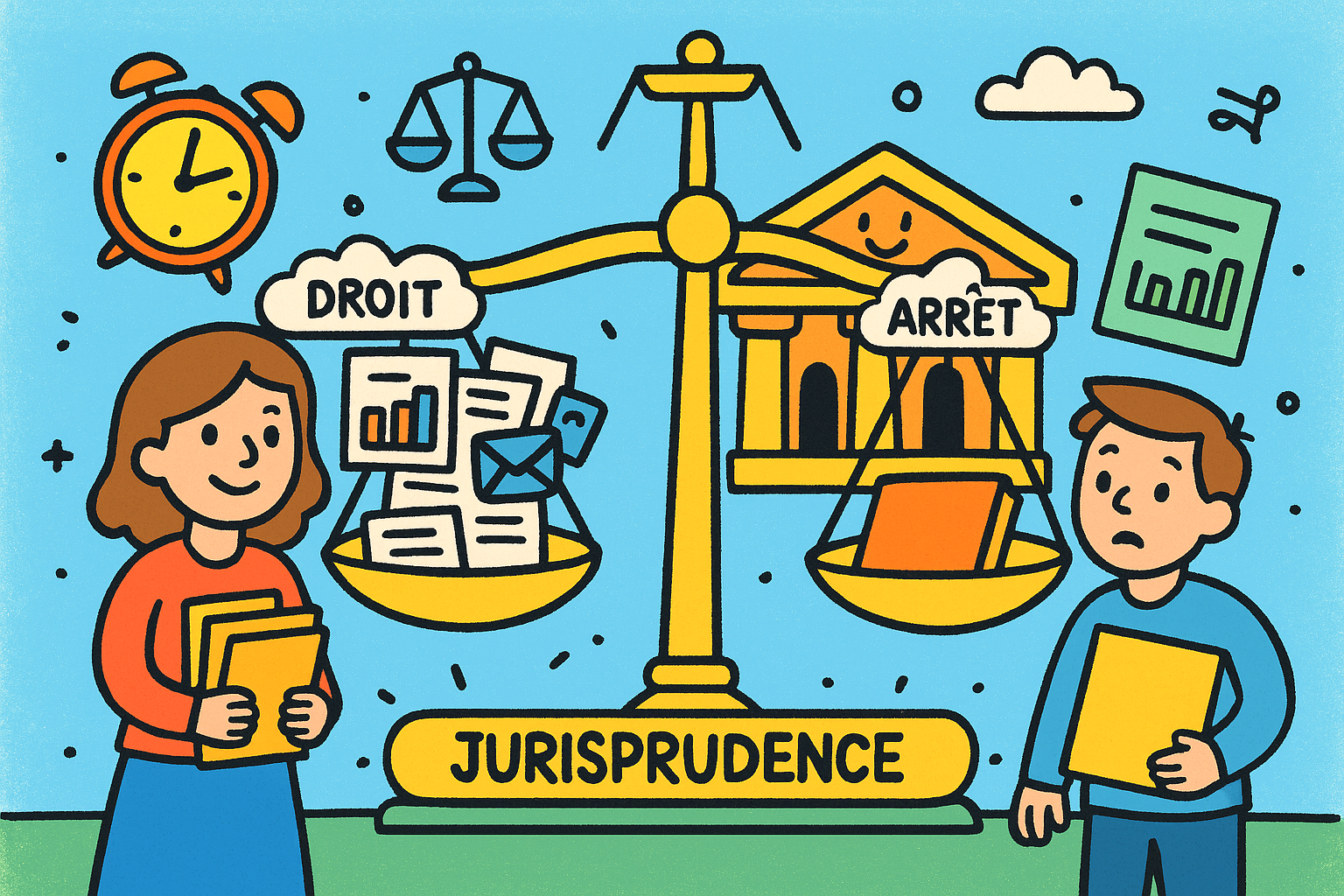
I. Rappel des faits
Une salariée, engagée en 2003 en qualité de responsable SAV et promue directrice en 2012, a saisi la juridiction prud'homale en janvier 2019. Elle demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement d'heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir réalisées entre 2016 et 2018.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
La salariée a initié une action devant le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le paiement d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
La cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 24 mai 2023, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé et à la résiliation du contrat.
La salariée a alors formé un pourvoi en cassation, articulé en trois moyens, reprochant notamment à la cour d'appel d'avoir fait peser sur elle seule la charge de la preuve des heures supplémentaires et d'avoir fait une interprétation erronée de l'obligation de décompte du temps de travail incombant à l'employeur.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation
1. Sur la preuve des heures supplémentaires : La cour d'appel a jugé que les éléments fournis par la salariée (tableaux de synthèse hebdomadaires renvoyant à des captures d'écran et des courriels) n'étaient pas "suffisamment précis" pour permettre à l'employeur d'y répondre. Elle a fondé son raisonnement sur le fait que la salariée disposait d'une grande autonomie, pouvait décaler ses horaires, et que les courriels envoyés tardivement ne répondaient pas à une urgence. Elle a donc fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée.
2. Sur l'obligation de décompte du temps de travail : La cour d'appel a retenu que l'article D. 3171-8 du code du travail, qui impose un décompte journalier et hebdomadaire du temps de travail, ne s'appliquait qu'aux salariés travaillant "en organisation par relais, par roulement ou par équipes successives", ce qui n'était pas le cas de la salariée. Elle en a déduit que l'employeur n'avait pas manqué à une obligation de décompte sur ce fondement.
IV. Problèmes de droit
1. Des éléments produits par un salarié, tels que des tableaux récapitulatifs hebdomadaires étayés par des courriels et des captures d'écran d'enregistrements de fichiers, sont-ils suffisamment précis au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail pour obliger l'employeur à fournir ses propres éléments de décompte du temps de travail ?
2. L'obligation de mettre en place un système de décompte individuel de la durée du travail, prévue par l'article D. 3171-8 du code du travail pour tout salarié non soumis à un horaire collectif, constitue-t-elle une déclinaison de l'obligation de sécurité de l'employeur, dont le manquement peut être suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ?
V. Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur deux fondements distincts.
1. Sur la preuve des heures supplémentaires : La Cour répond par l'affirmative. Elle juge qu'au vu des éléments présentés par la salariée (tableaux, captures d'écran, courriels), celle-ci présentait des éléments "suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre". En les écartant et en faisant peser la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a violé la loi.
• Visa : Article L. 3171-4 du code du travail.
2. Sur l'obligation de décompte : La Cour répond également par l'affirmative. Elle censure l'interprétation restrictive de la cour d'appel et affirme que dès lors qu'un salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte individuel de son temps de travail en application de l'article D. 3171-8 du code du travail. Se fondant sur le droit de l'Union européenne (CJUE, 14 mai 2019, C-55/18), elle lie cette obligation de décompte à l'obligation de sécurité de l'employeur (art. L. 4121-1). Par conséquent, la cour d'appel aurait dû rechercher si ce manquement était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
• Visas : Articles L. 4121-1 et D. 3171-8 du code du travail.
Commentaire d'arrêt
Cet arrêt de cassation partielle, rendu le 13 novembre 2025, offre une illustration claire et rigoureuse de deux principes fondamentaux du droit du travail : le régime de la preuve des heures supplémentaires et la portée de l'obligation de décompte du temps de travail. La chambre sociale y réaffirme sa jurisprudence constante sur la charge partagée de la preuve (I), tout en consacrant avec force le lien entre le suivi du temps de travail et l'obligation de sécurité, ouvrant la voie à la résiliation judiciaire en cas de manquement (II).
I. La preuve des heures supplémentaires : une charge partagée rigoureusement appliquée
La Cour de cassation censure la cour d'appel pour avoir fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée, rappelant ainsi les devoirs respectifs de chaque partie au litige. Elle réaffirme une appréciation souple des éléments initiaux que doit fournir le salarié (A) pour ensuite exiger de l'employeur qu'il assume sa part de la preuve (B).
A. L’appréciation extensive des "éléments suffisamment précis" fournis par le salarié
Conformément au régime probatoire de l'article L. 3171-4 du code du travail, la première étape incombe au salarié. Celui-ci doit présenter des "éléments suffisamment précis" pour permettre à l'employeur de répondre (Cour de cassation, 2025-09-10, 23-20.370, Cour de cassation, 2025-06-11, 24-14.457). En l'espèce, la Cour de cassation estime que les pièces produites – tableaux de synthèse hebdomadaires, impressions d'écran de fichiers avec heure d'enregistrement, courriels envoyés à des heures tardives – remplissaient cette condition.
"La Cour confirme ainsi que le salarié n'a pas à fournir une preuve parfaite, mais simplement un commencement de preuve factuel et matériel"
En jugeant que ces éléments étaient suffisamment précis, la Haute Juridiction s'oppose à l'analyse restrictive de la cour d'appel qui avait exigé une "preuve formelle". Elle confirme ainsi que le salarié n'a pas à fournir une preuve parfaite, mais simplement un commencement de preuve factuel et matériel, même s'il est établi unilatéralement, pour enclencher le mécanisme de la preuve partagée. Le statut de cadre ou la flexibilité horaire de la salariée sont jugés inopérants pour écarter ces éléments, comme le confirme une jurisprudence constante (Cour de cassation, 2025-09-10, 23-20.370).
B. Le basculement de la charge probatoire vers l’employeur, détenteur des outils de contrôle
Une fois le salarié ayant satisfait à sa charge initiale, il appartient à l'employeur, "qui assure le contrôle des heures de travail effectuées", de fournir ses propres éléments pour justifier des horaires réellement accomplis (Cour de cassation, 2025-09-10, 24-14.487, Cour de cassation - 05 avril 2023 - 22-10.397). Dans cette affaire, la Cour de cassation sanctionne les juges du fond pour avoir "fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée".
En se contentant d'analyser et de critiquer les pièces de la salariée sans exiger de l'employeur qu'il produise ses propres documents de décompte, la cour d'appel a violé le principe de la preuve partagée. L'arrêt rappelle implicitement que l'absence ou la défaillance des outils de suivi du temps de travail par l'employeur ne saurait jouer en sa faveur et faire obstacle à la demande du salarié qui a, de son côté, étayé ses prétentions.
II. L'obligation de décompte du temps de travail : un pilier de l'obligation de sécurité aux lourdes conséquences
Au-delà de la question probatoire, l'arrêt revêt une portée particulière en reliant l'obligation technique de décompte du temps de travail à l'obligation de sécurité (A), érigeant son non-respect en un manquement potentiellement justificateur de la rupture du contrat (B).
A. Une interprétation extensive de l'obligation de décompte individuel, sous l'influence du droit de l'Union
Le second apport majeur de la décision réside dans l'interprétation de l'article D. 3171-8 du code du travail. La Cour de cassation balaie l'argumentation restrictive de la cour d'appel et affirme que cette disposition s'applique à tout salarié "non soumis à l'horaire collectif", et non uniquement à ceux travaillant par relais ou roulement.
"La Cour de cassation balaie l'argumentation restrictive de la cour d'appel et affirme que cette disposition s'applique à tout salarié "non soumis à l'horaire collectif""
Surtout, la Cour ancre cette obligation dans un cadre plus large, celui de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. En visant conjointement les articles L. 4121-1 (obligation de sécurité) et D. 3171-8, et en se référant explicitement à l'arrêt *CCOO* de la CJUE du 14 mai 2019 (Cour de cassation - 22 mai 2024 - 22-22.443), elle érige le décompte du temps de travail en "système objectif, fiable et accessible" indispensable pour garantir les droits au repos et prévenir les risques psychosociaux. Le suivi du temps de travail n'est plus une simple formalité administrative, mais un instrument essentiel de l'obligation de sécurité de l'employeur (II) Le décompte du temps de travail comme composante de l'obligation de sécurité.
B. Un manquement susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat
La conséquence pratique de cette analyse est considérable. En cassant l'arrêt pour ne pas avoir "recherché si ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail", la Cour de cassation établit qu'une défaillance dans le système de décompte du temps de travail peut constituer une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
Ce faisant, elle ouvre la voie à une sanction sévère pour les employeurs qui négligent le suivi du temps de travail de leurs salariés en horaires individualisés. Le manquement n'est plus seulement un enjeu probatoire dans un litige sur les heures supplémentaires ; il devient un grief autonome, rattaché à l'obligation de sécurité, susceptible de provoquer la rupture de la relation de travail. Il appartiendra donc à la cour d'appel de renvoi d'apprécier, au cas par cas, si la gravité de ce manquement spécifique empêchait la poursuite du contrat (III) La résiliation judiciaire du contrat de travail comme sanction du manquement de l'employeur.