Procédure civile et procédures collectives : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2025, n° 24-20.133
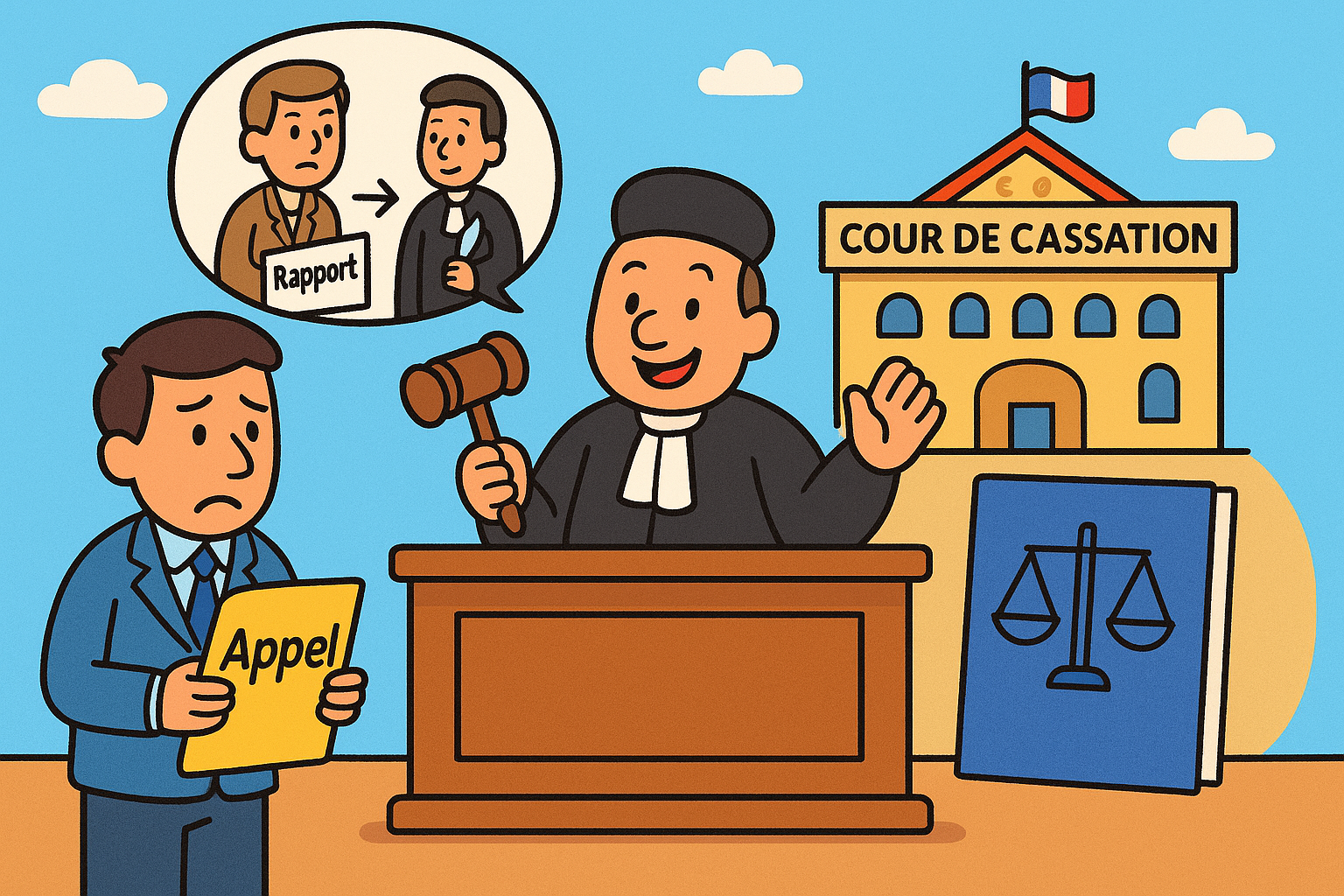
I. Rappel des faits
La société "Au Pain béni", dirigée par M. [K], a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires en 2019. Le liquidateur judiciaire, M. [Z], a par la suite engagé une action contre le dirigeant.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
Le liquidateur judiciaire a assigné M. [K] en première instance afin d'obtenir sa condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société, et de voir prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle.
La juridiction de première instance a fait droit aux demandes du liquidateur. M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [K], l'appelant, était représenté par un avocat et a conclu à l'infirmation du jugement. Le liquidateur, intimé, n'a pas constitué avocat mais a transmis à la cour un "rapport" dans lequel il présentait ses moyens et demandait la confirmation du jugement.
Par un arrêt du 20 juin 2024, la cour d'appel a confirmé la condamnation de M. [K] à payer 60 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
M. [K] a formé un pourvoi en cassation, arguant notamment que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le rapport du liquidateur, dès lors que ce dernier n'avait pas constitué avocat dans une procédure où la représentation est obligatoire.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé qu'elle pouvait valablement statuer en se fondant sur un "rapport" adressé par le liquidateur judiciaire. Ce faisant, elle a considéré que cet acte, bien qu'émanant d'une partie non représentée par un avocat, était suffisant pour prendre en considération les prétentions et moyens de l'intimé dans le cadre de la procédure d'appel.
IV. Problème de droit
Dans une procédure d'appel où la représentation par avocat est obligatoire, une cour d'appel peut-elle valablement fonder sa décision sur les prétentions et moyens contenus dans un rapport émanant d'une partie qui n'a pas constitué avocat ?
V. Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation répond par la négative et casse et annule l'arrêt au visa des articles 899 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce.
Elle énonce qu'il résulte des textes visés que l'appel des jugements en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de sanctions personnelles est instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire (Arrêt utilisateur, paragraphe 5).
Par conséquent, la cour d'appel ne pouvait pas prendre en considération des prétentions et des moyens qui n'avaient pas été formés par la voie de conclusions déposées par un avocat (paragraphe 8). En se fondant sur le rapport du liquidateur qui n'avait pas constitué avocat pour condamner le dirigeant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Commentaire d'arrêt
Par un arrêt du 19 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler avec force le formalisme procédural qui encadre le contentieux de la responsabilité des dirigeants en appel. En censurant une cour d’appel qui avait tenu compte des écritures d’un liquidateur non représenté, la Haute Juridiction réaffirme le caractère impératif des règles relatives à la représentation obligatoire. Cette décision, rendue sur un pur moyen de procédure, est l'occasion de revenir sur le principe strict de la représentation en appel (I) et sur la portée radicale de la sanction qui en découle (II).
I. L'application rigoureuse du principe de la représentation obligatoire en appel
La Cour de cassation fonde sa décision sur le non-respect d'une règle procédurale fondamentale, rappelant que le cadre légal de la représentation est sans équivoque (A) et rend inefficaces tous les actes de procédure informels (B).
A. Le fondement textuel sans équivoque de l'obligation
La solution de la Cour de cassation repose sur une base légale claire et double. Elle vise conjointement l'article 899 du Code de procédure civile, qui pose le principe de la représentation obligatoire par avocat en appel (Code de procédure civile - Article - 954), et l'article R. 661-6 du Code de commerce, qui étend spécifiquement cette exigence aux appels des jugements en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de sanctions personnelles (paragraphe 5).
"le liquidateur judiciaire, bien qu'agissant dans l'intérêt des créanciers, n'échappe pas à cette exigence lorsqu'il est partie à l'instance d'appel"
L'articulation de ces deux textes ne laisse aucune place à l'interprétation. En matière de sanctions patrimoniales ou personnelles contre un dirigeant, le législateur a entendu soumettre la procédure d'appel au formalisme le plus strict, garantissant ainsi un débat contradictoire équilibré et techniquement encadré par des professionnels du droit. La Cour de cassation ne fait ici qu'une application littérale et orthodoxe de ces dispositions, confirmant que le liquidateur judiciaire, bien qu'agissant dans l'intérêt des créanciers, n'échappe pas à cette exigence lorsqu'il est partie à l'instance d'appel (paragraphe 6).
B. L'inefficacité des actes de procédure informels
La Cour de cassation tire la conséquence logique de ce principe : tout acte qui ne respecte pas les formes prescrites est dénué d'effet. En l'espèce, le liquidateur avait produit un "rapport" pour exposer ses prétentions et ses moyens. La Haute Juridiction souligne que cet écrit ne peut être assimilé à des conclusions d'avocat au sens des articles 954 et 961 du Code de procédure civile.
Ces dernières doivent être déposées par un avocat constitué et respecter un formalisme précis. Le "rapport", quelle que soit sa qualité ou sa pertinence sur le fond, est un acte irrégulier car il émane d'une partie non habilitée à postuler directement devant la cour. En jugeant que la cour d'appel "ne pouvait pas prendre en considération" de telles écritures (paragraphe 8), la Cour de cassation signifie que ces actes doivent être considérés comme juridiquement inexistants pour le juge. Ce faisant, elle préserve l'intégrité de la procédure et le monopole de la représentation des avocats.
II. La portée et les conséquences de la sanction procédurale
La violation du principe de représentation obligatoire n'est pas une simple irrégularité ; elle emporte une sanction radicale (A), qui constitue un avertissement sévère pour toutes les parties à une procédure (B).
A. La cassation inévitable de la décision des juges du fond
La sanction prononcée par la Cour de cassation est la plus lourde qui soit : la cassation et l'annulation "en toutes ses dispositions" de l'arrêt d'appel. Cette censure totale est la conséquence directe de la nature de la faute commise par la cour d'appel. En se fondant sur un acte irrégulier, elle a vicié sa propre décision à la racine.
"En se fondant sur un acte irrégulier, la Cour d'appel a vicié sa propre décision à la racine"
La violation d'une règle fondamentale de procédure, qualifiable de nullité de fond, ne permet pas une cassation partielle. Le raisonnement des juges du fond ayant été entièrement étayé par des éléments qu'ils n'auraient pas dû examiner, il est impossible de sauver une partie de leur décision. L'affaire est donc remise "dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt", obligeant la cour d'appel de renvoi à statuer à nouveau, mais cette fois-ci sur la base des seules conclusions régulièrement déposées par les parties, en l'occurrence, celles de l'appelant.
B. Un rappel strict à l'égard de toutes les parties, y compris le liquidateur
Cet arrêt est un rappel pédagogique adressé à tous les acteurs judiciaires. Il concerne au premier chef le liquidateur judiciaire (paragraphe 3 ; Code de commerce - Article - L641-14). Même en qualité d'intimé, et même si son rôle est de défendre l'intérêt collectif des créanciers, il est soumis aux mêmes obligations procédurales que tout autre justiciable. S'il entend voir ses prétentions et moyens examinés en appel, il doit impérativement constituer avocat.
Plus largement, cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle le respect des règles de procédure, en particulier celles qui garantissent les droits de la défense et le principe du contradictoire. Pour le juriste praticien, c'est la confirmation qu'aucune économie, fût-elle de temps ou d'argent, ne peut justifier de s'affranchir des règles de représentation lorsque celles-ci sont obligatoires, sous peine de voir anéantir l'ensemble d'une procédure et la décision qui en est issue.