Procédures collectives : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2025, n° 24-14.924
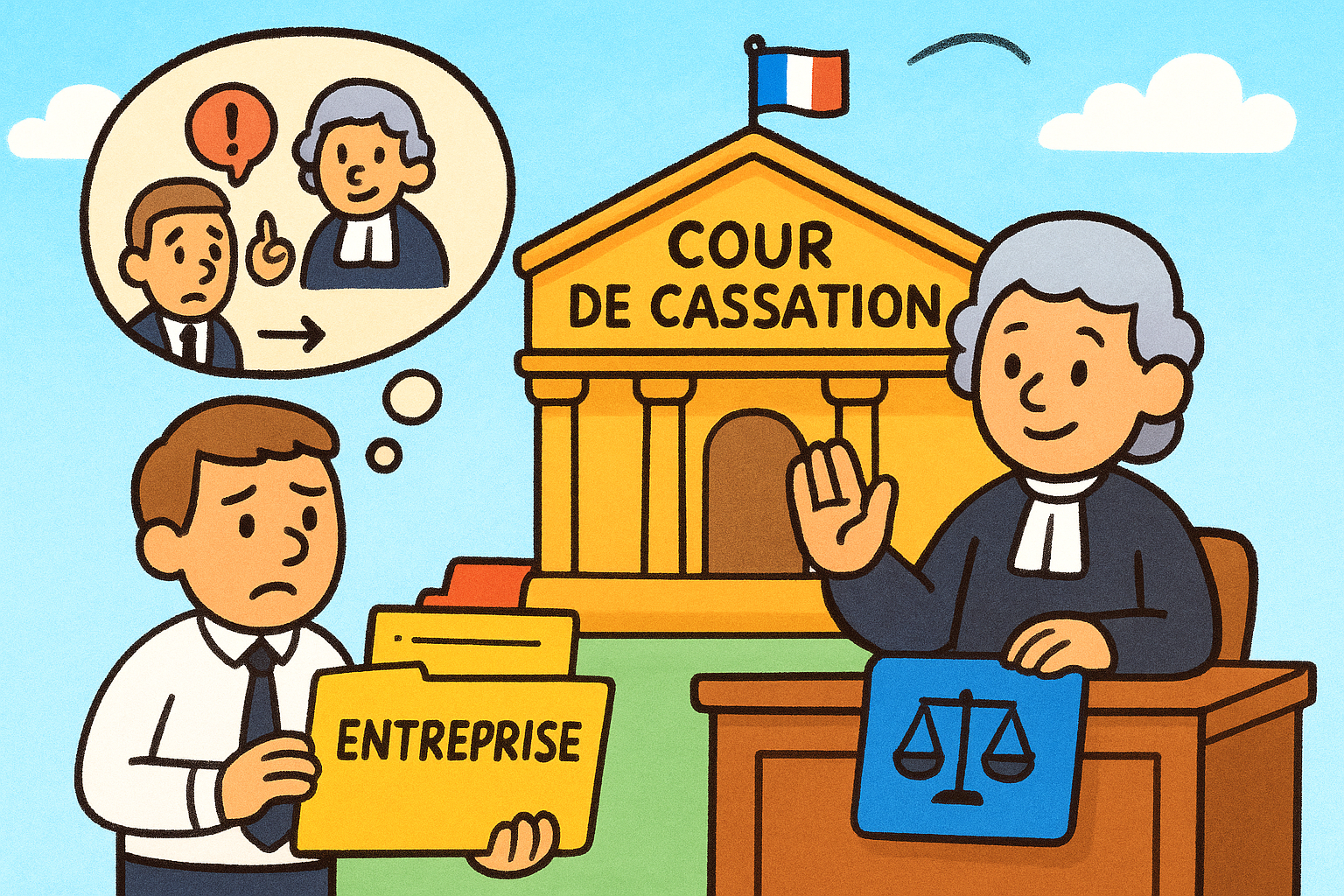
I. Rappel des faits
Le 23 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Soissons, agissant en vertu de l'article L. 640-3-1 du code de commerce, a informé le procureur de la République de faits pouvant justifier l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Génard père et fils travaux publics (GPFTP). Suite à la saisine du tribunal par le procureur, le même président de tribunal a été commis le 8 décembre 2022 pour recueillir des renseignements sur la situation financière de la société. Le 11 mai 2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GPFTP.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
La société GPFTP a contesté la régularité du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Après un premier jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 11 mai 2023, la société a interjeté appel. La cour d'appel d'Amiens, par un arrêt du 7 mars 2024, a rejeté les prétentions de la société.
La société GPFTP a alors formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que la désignation du président du tribunal comme juge enquêteur, alors que ce dernier avait lui-même initié la procédure en alertant le ministère public, portait atteinte au principe d'impartialité garanti par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH). Selon la demanderesse, le juge ne pouvait être exempt de tout soupçon de partialité en étant chargé d'établir un rapport sur l'opportunité d'ouvrir une procédure qu'il avait personnellement sollicitée.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La thèse de la société demanderesse au pourvoi, qui a été rejetée, consistait à affirmer que le principe d'impartialité de l'article 6 §1 de la CEDH s'applique au juge enquêteur désigné en application de l'article L. 621-1 du code de commerce. Selon cette thèse, le cumul des fonctions d'initiateur de l'alerte au parquet et d'enquêteur chargé de rapporter sur l'opportunité de la procédure crée un doute légitime sur la neutralité du juge, viciant ainsi la procédure. La cour d'appel d'Amiens avait déjà rejeté cette thèse en considérant que le tribunal avait pu régulièrement confier cette mission au juge concerné.
IV. Problème de droit
Le juge commis en application de l'article L. 621-1 du code de commerce, dont la mission est de recueillir des renseignements sur la situation d'une entreprise, est-il soumis à l'exigence d'impartialité telle que prévue par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ?
V. Réponse donnée par la Cour
La Cour de cassation répond par la négative.
Elle énonce que le juge commis pour recueillir des renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise "n'est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise". Par conséquent, il ne constitue pas un "tribunal" au sens de l'article 6 §1 de la CEDH et n'est donc pas assujetti, à ce titre, au devoir d'impartialité prévu par ce texte. Le moyen de la demanderesse, qui postulait le contraire, est donc rejeté.
Commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 novembre 2025 apporte un éclaircissement essentiel sur le périmètre d'application des garanties du procès équitable dans le cadre des procédures collectives. En rejetant le pourvoi d'une société qui contestait la partialité du juge enquêteur, la haute juridiction confirme une vision fonctionnelle des garanties procédurales, distinguant nettement la phase d'information de la phase de jugement. Cette décision clarifie la portée de l'article 6 §1 de la CEDH en droit des entreprises en difficulté, en consacrant une qualification restrictive de la mission du juge enquêteur (I), tout en rappelant implicitement que l'impartialité de la procédure est assurée par d'autres mécanismes (II).
I. La qualification restrictive de la mission du juge enquêteur, exclusive de l'application de l'article 6 §1 de la CEDH
La Cour de cassation fonde sa décision sur une analyse stricte de la nature de l'intervention du juge commis (A), ce qui a pour conséquence directe d'écarter l'application du devoir d'impartialité tel qu'envisagé par la Convention européenne (B).
A. Une mission d'information distincte de la fonction de jugement
La solution de la Cour repose entièrement sur la distinction entre la mission d'investigation et l'acte de juger. Elle précise que le juge commis sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de commerce a pour seule tâche de "recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise". Ce faisant, il n'est "pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil" de la société (Tribunal de commerce, 2025-02-19, 2025P00010).
"La solution de la Cour repose entièrement sur la distinction entre la mission d'investigation et l'acte de juger"
Cette analyse fonctionnelle est déterminante : le juge enquêteur instruit, il ne tranche pas. Il agit en amont de la décision juridictionnelle pour éclairer la formation de jugement. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence administrative qui distingue également la "phase préalable des enquêtes et contrôles" de la "procédure de sanction" à laquelle seule s'applique l'article 6 §1 de la CEDH (CE, 24 juillet 2025, 471654). En qualifiant la mission du juge commis de simple mesure préparatoire, la Cour de cassation lui dénie la qualité de "tribunal" au sens de la Convention, condition nécessaire à l'application des garanties qui y sont attachées.
B. L'exclusion consécutive du devoir d'impartialité conventionnel
La qualification de la mission du juge commis entraîne une conséquence logique et directe : son exclusion du champ d'application du devoir d'impartialité prévu par l'article 6 §1 de la CEDH. La Cour énonce sans ambiguïté que, n'étant pas un "tribunal", ce juge "n'est pas assujetti, à ce titre, au devoir d'impartialité prévu par ce texte".
Cette position, si elle peut sembler surprenante au premier abord, est rigoureuse sur le plan juridique. Elle ne nie pas l'importance de l'impartialité, mais la cantonne à la phase décisionnelle. Le grief du demandeur, qui invoquait un "doute légitime" sur la neutralité du juge ayant à la fois alerté le parquet et mené l'enquête, est ainsi jugé inopérant car il se fonde sur une garantie qui n'est pas applicable à cette étape de la procédure. La Cour refuse de transposer les exigences pesant sur la formation de jugement à un acteur dont le rôle est strictement informatif.
II. La préservation de l'impartialité de la procédure par d'autres garanties
Si l'arrêt écarte l'application de l'article 6 §1 de la CEDH au juge enquêteur, il ne laisse pas la procédure sans protection contre la partialité. L'impartialité de la décision finale est en réalité assurée par la séparation des fonctions (A) et par une obligation déontologique générale qui continue de peser sur tous les juges (B).
A. Une impartialité garantie par la séparation des fonctions d'enquête et de jugement
Le droit français des procédures collectives organise lui-même une garantie structurelle d'impartialité. En effet, l'article R. 621-4 du code de commerce prévoit que le juge qui a été commis pour établir le rapport "ne peut siéger ni participer au délibéré" de la formation de jugement qui statuera sur l'ouverture de la procédure.
"L'impartialité est donc déplacée de la personne de l'enquêteur vers la structure même de la formation de jugement"
Cette règle d'incompatibilité est la clé de voûte du système. Elle assure une séparation stricte entre celui qui instruit et ceux qui jugent. La cour d'appel d'Amiens, dans une décision antérieure, avait d'ailleurs souligné que ces deux rôles sont "complémentaires" mais "strictement séparés" (CA, Amiens, 7 mars 2024, 23/02334). Ainsi, même si le juge enquêteur a pu se forger une opinion, celle-ci ne se transmet à la formation de jugement que par le biais d'un rapport débattu contradictoirement, sans que son auteur ne puisse influencer le délibéré. L'impartialité est donc déplacée de la personne de l'enquêteur vers la structure même de la formation de jugement.
B. La persistance d'une obligation déontologique générale d'impartialité
L'arrêt du 19 novembre 2025 doit être lu avec précaution : il n'exonère pas le juge commis de toute obligation de neutralité. Il précise uniquement que le devoir d'impartialité de l'article 6 §1 de la CEDH ne lui est pas applicable "à ce titre". Or, le droit interne impose des exigences propres. L'article L. 722-18 du code de commerce dispose que les juges des tribunaux de commerce "exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité".
Cette obligation déontologique a une portée générale et s'applique à l'ensemble des missions confiées à un juge consulaire, y compris l'enquête. Si la Cour de cassation estime que la violation de cette obligation générale ne peut être sanctionnée sur le fondement de l'article 6 §1 de la CEDH dans ce contexte, il n'en demeure pas moins que le juge enquêteur reste tenu à un comportement impartial. La solution de la Cour de cassation ne donne donc pas un blanc-seing à la partialité, mais opère une distinction technique entre la source de l'obligation et les modalités de sa sanction.