R&D externalisée : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, 16 octobre 2025, n° 23MA02441
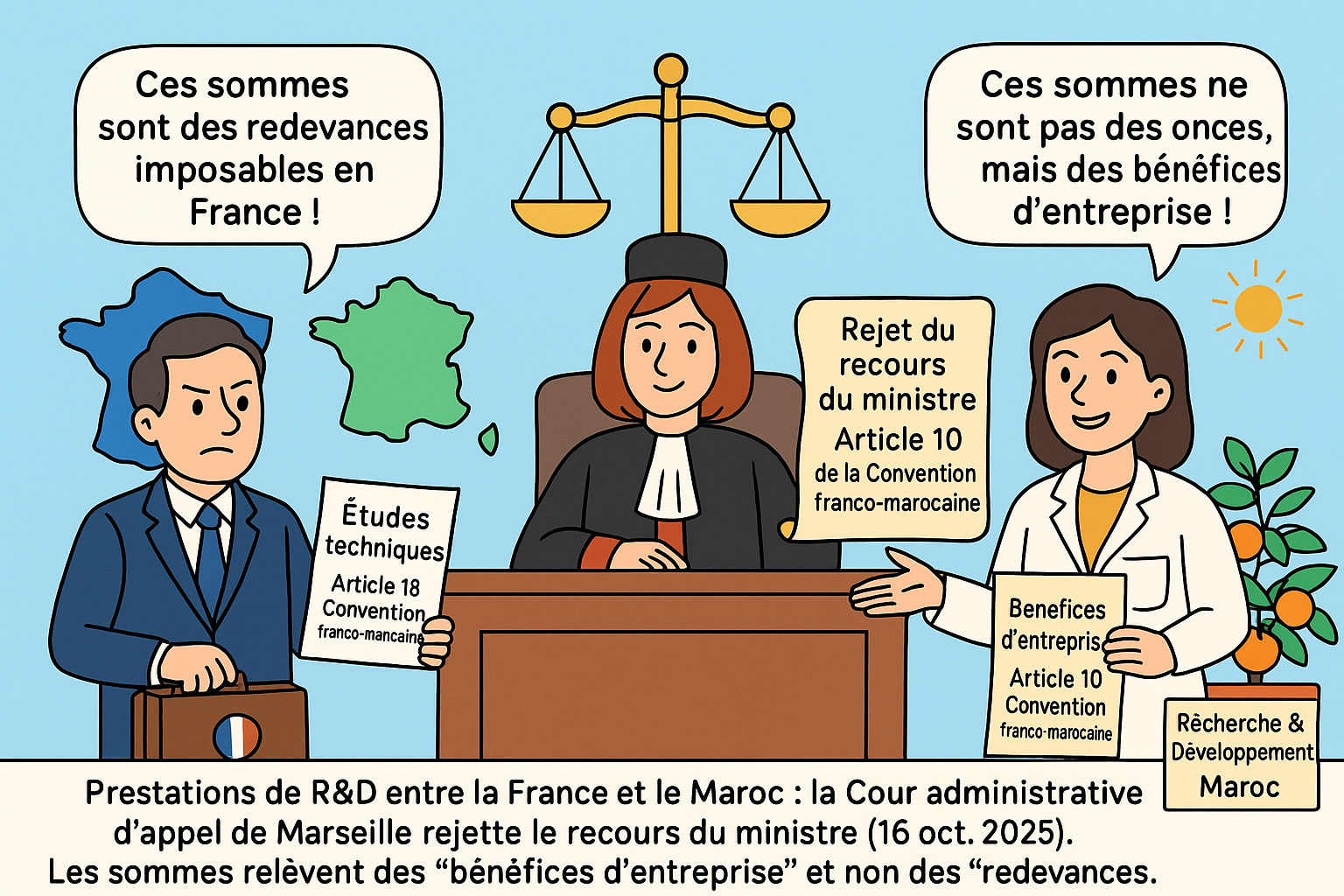
I. Rappel des faits
La SARL Nador Cott Protection, qui commercialise une variété d'agrume protégée par un certificat d'obtention végétale (COV), a versé en 2017 la somme de 1 625 000 euros à deux entités marocaines (l'INRA Maroc et la SA Agrimed) pour financer des travaux de recherche et développement (R&D). L'administration fiscale française a considéré ces sommes comme des redevances pour des prestations utilisées en France et a, par conséquent, appliqué une retenue à la source de 10 % sur le fondement de l'article 182 B du Code général des impôts (CGI), assortie d'une majoration de 10 % pour retard de paiement.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
- Procédure de première instance : La SARL Nador Cott Protection a contesté la retenue à la source devant le tribunal administratif de Toulon, qui, par un jugement du 23 mai 2023, a prononcé la décharge de l'imposition.
- Procédure d'appel : Le ministre de l’Économie a fait appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Marseille.
- Prétentions des parties en appel :
• Le ministre de l’Économie (appelant) soutenait que les sommes versées devaient être qualifiées d'« études techniques » au sens de l’article 16, paragraphe 2, c) de la convention fiscale franco-marocaine. En conséquence, ces sommes constitueraient des redevances imposables en France par voie de retenue à la source, conformément à l'article 182 B du CGI.
• La SARL Nador Cott Protection (intimée) faisait valoir que ces sommes ne constituaient pas des redevances mais des « bénéfices d'entreprise » relevant de l'article 10 de la convention. En l'absence d'établissement stable des entités marocaines en France, ces bénéfices ne seraient imposables qu'au Maroc, faisant ainsi obstacle à l'application de la retenue à la source française.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour
La thèse du ministre de l’Économie, rejetée par la Cour, consistait à considérer que toute prestation de recherche et développement dont les résultats sont exploités en France constitue une prestation « utilisée en France » au sens de l’article 182 B du CGI. De plus, selon cette thèse, de telles prestations de R&D devaient être qualifiées d'« études techniques » au sens de l'article 16 de la convention fiscale franco-marocaine. Cette double qualification justifiait l'imposition en France par le mécanisme de la retenue à la source.
IV. Problème de droit
Des sommes versées par une société française à des entités marocaines en rémunération de prestations de recherche et développement doivent-elles être qualifiées de « redevances » pour « études techniques » au sens de l'article 16 de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970, et ainsi être soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI, ou constituent-elles des « bénéfices d'entreprise » au sens de l'article 10 de ladite convention, dont l'imposition est réservée au Maroc en l'absence d'établissement stable en France ?
V. Réponse de la Cour
La Cour administrative d’appel de Marseille rejette le recours du ministre.
Elle juge que, bien que les prestations de R&D soient effectivement « utilisées en France » car nécessaires à l'activité de la société française (TA, Toulon, 14 mai 2025, 2300124), elles ne peuvent être qualifiées d'« études techniques » au sens de l'article 16, paragraphe 2, c) de la convention fiscale franco-marocaine, eu égard à leurs caractéristiques et au savoir-faire qu'elles impliquent.
Par conséquent, ces sommes relèvent de la catégorie des « bénéfices d'entreprise » visée à l'article 10 de la convention. En l'absence d'établissement stable des entités marocaines en France, la convention fait obstacle à l'application de la retenue à la source prévue par le droit interne français (TA, Toulon, 14 mai 2025, 2300124).
Commentaire d'arrêt
La récente décision de la Cour administrative d’appel de Marseille du 16 octobre 2025 clarifie le traitement fiscal des sommes versées pour des prestations de recherche et développement (R&D) transfrontalières, dans le cadre de la convention franco-marocaine. En suivant une méthode d'analyse rigoureuse, la Cour confirme une interprétation restrictive de la notion de redevance, privilégiant la qualification de bénéfices d'entreprise. L'arrêt illustre ainsi parfaitement la méthode d'articulation entre le droit fiscal interne et le droit conventionnel (I), avant de préciser la portée de la qualification retenue, qui s'inscrit dans une jurisprudence tendant à limiter le champ des retenues à la source (II).
I. La double qualification des prestations au regard du droit interne et du droit conventionnel
La Cour suit la méthodologie établie par le Conseil d'État en procédant à une analyse en deux temps : elle vérifie d'abord l'applicabilité de la loi fiscale française (A) avant de déterminer si la convention internationale y fait obstacle (B).
A. La confirmation d’une conception large du critère d’« utilisation en France »
Dans un premier temps, la Cour examine si les conditions d’application de l’article 182 B du CGI sont réunies. Ce texte soumet à une retenue à la source les sommes payées à des non-résidents pour des prestations de toute nature « fournies ou utilisées en France ». En l’espèce, la Cour valide la position de l'administration sur ce point, en jugeant que les prestations de R&D réalisées au Maroc étaient bien « utilisées en France » car elles étaient « absolument nécessaires à l'activité, exercée exclusivement en France » de la SARL Nador Cott Protection (TA, Toulon, 14 mai 2025, 2300124).
"Cette position confirme une interprétation extensive du critère d'utilisation, où le lieu d'exploitation économique des résultats de la prestation prime sur le lieu de sa réalisation matérielle"
Cette position confirme une interprétation extensive du critère d'utilisation, où le lieu d'exploitation économique des résultats de la prestation prime sur le lieu de sa réalisation matérielle. Cette première étape, favorable à l'administration, est fondamentale car elle établit le principe de l'imposition en droit interne, condition nécessaire pour passer à l'analyse conventionnelle.
B. Le rappel de la méthode d’articulation entre la loi fiscale et la convention internationale
Dans un second temps, et conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'État, la Cour vérifie si la convention fiscale franco-marocaine fait obstacle à l'application de l'article 182 B du CGI. Cette démarche en deux temps est un principe fondamental du droit fiscal international français (Conseil d'Etat, Décision, 2022-07-05, 455789, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/02/2025, 491788). Le juge doit d'abord qualifier l'imposition au regard du droit interne, puis rapprocher cette qualification des stipulations de la convention pour déterminer si celle-ci limite ou supprime le droit d'imposer de la France.
En l'espèce, la Cour ne s'arrête pas à la qualification interne. Elle se livre à un exercice de qualification des revenus au regard des catégories prévues par la convention (redevances vs. bénéfices d'entreprise), démontrant que la convention n'est pas une simple dérogation mais un corps de règles qui redéfinit la répartition du pouvoir d'imposer entre les deux États.
II. La portée de la qualification retenue : une interprétation restrictive de la notion de redevance
Le cœur de la décision réside dans la qualification des prestations de R&D au regard de la convention. En les excluant de la catégorie des redevances (A), la Cour confirme le principe d'imposition des bénéfices dans l'État de résidence en l'absence d'établissement stable (B).
A. L'exclusion des prestations de R&D de la catégorie des « études techniques »
Le ministre de l’Économie soutenait que les prestations de R&D constituaient des « études techniques » au sens de l'article 16 de la convention, justifiant leur qualification de redevances. La Cour écarte cette analyse, estimant que « eu égard à leurs caractéristiques [...] et au savoir-faire qu'elles impliquent », les prestations en cause ne se limitent pas à de simples études (TA, Toulon, 14 mai 2025, 2300124).
"Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d'État qui interprète de manière restrictive la notion de redevances"
Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d'État qui interprète de manière restrictive la notion de redevances. Par exemple, il a déjà été jugé, y compris dans le cadre de la convention franco-marocaine, que des prestations de services (notamment informatiques) ne relèvent pas des redevances si elles n'impliquent pas le transfert d'un savoir-faire ou la fourniture d'études techniques spécifiques (Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/06/2021, 433319, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/06/2021, 433323). En appliquant ce raisonnement à des prestations de R&D, la Cour confirme que la technicité d'une prestation ne suffit pas, à elle seule, à la qualifier de redevance conventionnelle.
B. La consécration de l'imposition des bénéfices en l'absence d'établissement stable
La conséquence de cette qualification est que les sommes versées relèvent de l'article 10 de la convention, relatif aux « bénéfices d'entreprise ». Selon cet article, de tels bénéfices ne sont imposables que dans l'État de résidence du prestataire (le Maroc), à moins que celui-ci ne dispose d'un « établissement stable » dans l'État de la source (la France).
"Cette décision renforce la sécurité juridique pour les entreprises françaises qui financent de la R&D à l'étranger auprès d'entités non liées disposant de leurs propres moyens"
L'absence d'établissement stable des entités marocaines en France étant avérée (TA, Toulon, 14 mai 2025, 2300124), la Cour conclut logiquement que la convention fait obstacle à la retenue à la source. Cette décision renforce la sécurité juridique pour les entreprises françaises qui financent de la R&D à l'étranger auprès d'entités non liées disposant de leurs propres moyens. Elle réaffirme le rôle central de la notion d'établissement stable comme critère de rattachement territorial pour l'imposition des bénéfices d'activités, conformément au modèle des conventions fiscales internationales (Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21/01/2021, 429996, Inédit au recueil Lebon, Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11/12/2020, 420174, Publié au recueil Lebon).