Report des congés payés en cas d'arrêt maladie : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025, pourvoi n°23-22.732
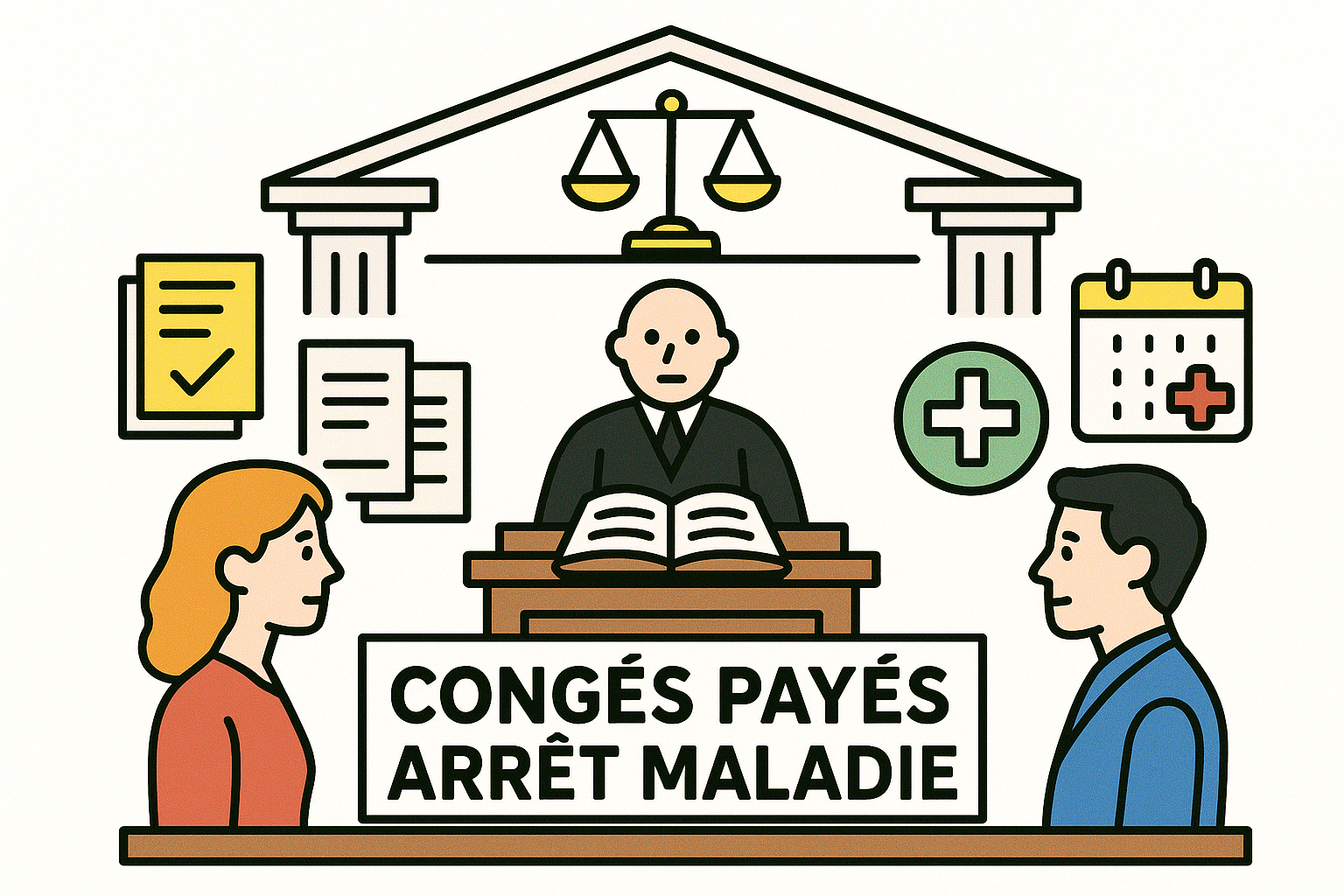
Bonne nouvelle pour les salariés, mauvaise pour les employeurs !
Désormais, lorsqu’un salarié est en arrêt maladie pendant ses congés payés, et qu’il en informe son employeur, il bénéficie d’un droit au report de ses congés payés.
Cette décision intervient dans un contexte de durcissement des règles d’obtention des arrêts maladie par le gouvernement, dans un objectif de lutte contre la fraude sociale, et de réduction du déficit public.
Il semblerait donc que ce que le gouvernement prend d’une main, le juge nous le rend de l'autre ..
1. Rappel des faits
Une médecin du travail, employée depuis 1990 par une association de santé au travail, est passée à temps partiel en 2002. Un avenant à son contrat prévoyait que les heures complémentaires effectuées s'imputeraient sur les congés scolaires pris au-delà de ses droits. La salariée a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté l'entreprise le 31 décembre 2016. Elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat.
2. Procédure et prétentions des parties
Première instance : Saisie du conseil de prud'hommes par la salariée le 9 mai 2017.
Appel : La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 15 mars 2023, a statué sur les demandes de la salariée et la demande reconventionnelle de l'employeur.
Pourvoi en cassation :
La salariée (demanderesse au pourvoi principal) conteste le rejet de sa demande d'heures complémentaires et sa condamnation à rembourser des congés payés jugés indûment perçus. Elle soutient que l'action de l'employeur est prescrite et que le décompte de ses congés (notamment RTT et CET) par la cour d'appel est erroné.
L'employeur (demandeur au pourvoi incident) conteste la décision de la cour d'appel d'avoir déduit du solde de congés de la salariée les jours d'arrêt maladie survenus pendant ses vacances, lui permettant ainsi de les reporter.
3. Thèse opposée à la Cour de cassation
La thèse rejetée par la Cour de cassation était celle de l'employeur, fondée sur la jurisprudence antérieure (Soc., 4 décembre 1996, n° 93-44.907). Selon cette thèse, un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés ne peut pas exiger de reporter les jours de congé correspondants, car l'employeur s'est déjà acquitté de son obligation en lui accordant la période de congé initialement prévue.
4. Problèmes de droit
La Cour de cassation était saisie de trois questions principales :
1. Un salarié tombant malade durant ses congés payés a-t-il le droit de reporter les jours de congés coïncidant avec son arrêt de travail ?
2. Quel est le point de départ du délai de prescription triennale de l'action en répétition de l'indu exercée par un employeur au titre d'indemnités de congés payés versées à tort ?
3. Selon quelles modalités doivent être décomptés les jours de repos à caractère compensatoire (RTT, CET) pour un salarié à temps partiel ?
5. Réponses de la Cour
1. Oui. Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour juge, en interprétant l'article L. 3141-3 du Code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE et de la jurisprudence de la CJUE, qu'un salarié en arrêt maladie pendant ses congés payés a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé coïncidant avec la période de maladie. Elle rejette donc le pourvoi de l'employeur sur ce point.
"un salarié en arrêt maladie pendant ses congés payés a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé coïncidant avec la période de maladie"
2. Le point de départ est le jour du paiement de l'indemnité indue. La Cour casse l'arrêt d'appel qui avait fixé ce point de départ à l'expiration de la période de prise des congés. Elle précise que le délai de prescription court à compter du paiement, si l'employeur était alors en mesure de déceler l'erreur et de demander la restitution.
3. Les jours de repos à caractère compensatoire doivent être décomptés sur les jours où le salarié à temps partiel est censé travailler. La Cour casse l'arrêt d'appel pour ne pas avoir vérifié si ce mode de décompte spécifique, qui déroge à la règle des jours ouvrables appliquée aux congés payés légaux, avait été respecté.
Commentaire d’arrêt
L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 septembre 2025 revêt une importance capitale, tant par le revirement de jurisprudence qu'il opère en matière de congés payés que par les précisions techniques qu'il apporte sur des sujets connexes. En s'alignant sur le droit de l'Union européenne, la Cour consacre le droit au report des congés en cas de maladie survenant pendant leur prise, une solution attendue et protectrice des droits du salarié (I). Par ailleurs, elle clarifie des règles essentielles relatives à la prescription de l'action en répétition de l'indu et au décompte des congés pour les salariés à temps partiel (II).
I. La consécration du droit au report des congés payés en cas de maladie : un alignement sur le droit de l’Union européenne
La portée principale de cet arrêt réside dans le revirement de jurisprudence qu'il opère concernant l'articulation entre congé annuel et maladie, consacrant une solution dictée par le droit de l'Union européenne.
A. L'abandon d'une jurisprudence nationale obsolète
Jusqu'à présent, la position de la Cour de cassation, établie depuis un arrêt de 1996 (Soc., 4 décembre 1996, pourvoi n° 93-44.907), était que « le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier ». L'employeur était considéré comme s'étant acquitté de son obligation.
"Jusqu'à présent, la position de la Cour de cassation, établie depuis un arrêt de 1996 était que « le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier »"
Dans la présente décision, la Cour abandonne explicitement cette solution. Elle juge désormais qu'il « convient de juger désormais » que le salarié a le droit de bénéficier ultérieurement de ses jours de congés. En rejetant le moyen de l'employeur qui invoquait l'ancienne jurisprudence, la chambre sociale met fin à une solution qui apparaissait de plus en plus isolée et contraire à la finalité du droit au repos.
B. L’interprétation conforme, vecteur de primauté du droit de l'Union
Ce revirement est directement fondé sur le droit de l'Union européenne. La Cour de cassation s'appuie sur la finalité du droit au congé annuel, qualifié de « principe essentiel du droit social de l'Union » (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal), qui est de permettre au travailleur de se reposer, finalité distincte de celle du congé maladie visant au rétablissement (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff).
Pour ce faire, la Cour utilise la technique de l'interprétation conforme : elle lit l'article L. 3141-3 du Code du travail « à la lumière de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE », tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt ANGED du 21 juin 2012. Cet arrêt européen s'opposait déjà à des dispositions nationales privant le travailleur du droit de reporter ses congés en cas de maladie. La Cour de cassation assure ainsi la pleine effectivité du droit de l'Union, sans attendre une intervention du législateur.
II. Les précisions techniques sur l'action en répétition et le décompte des congés
Au-delà de ce revirement majeur, l'arrêt apporte deux clarifications techniques importantes, relatives à la prescription des créances salariales et aux modalités de décompte des congés d'un salarié à temps partiel.
A. La prescription de l'action en répétition de l'indu : la fixation du point de départ au jour du paiement
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur la question de la prescription de l'action de l'employeur en remboursement de congés payés indûment versés. La cour d'appel avait retenu comme point de départ « l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient dû être pris ».
"l'exigibilité de la créance en restitution naît au moment du paiement erroné "
La chambre sociale censure ce raisonnement en rappelant que, pour une action en répétition de salaire (ce qu'est l'indemnité de congé payé), le délai de prescription triennal de l'article L. 3245-1 du Code du travail « court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur était en mesure de déceler le paiement indu ». Cette solution est logique : l'exigibilité de la créance en restitution naît au moment du paiement erroné, et non à une date ultérieure liée à la période de prise des congés, laquelle concerne le droit du salarié à réclamer son congé, et non le droit de l'employeur à répéter un indu.
B. Le décompte des congés du salarié à temps partiel : la distinction entre congés légaux et compensatoires
Enfin, la Cour précise les règles de décompte des jours de repos pour un salarié à temps partiel. Elle rappelle d'abord le principe d'égalité de traitement (art. L. 3123-5 du Code du travail) : les congés payés légaux se décomptent en jours ouvrables, comme pour un salarié à temps plein.
Toutefois, elle censure la cour d'appel pour ne pas avoir appliqué l'exception relative aux « congés revêtant un caractère compensatoire » (tels que les RTT ou jours de CET). Pour ces jours spécifiques, le décompte ne doit pas se faire en jours ouvrables, mais doit être imputé « sur des jours durant lesquels il est normalement prévu que la salariée à temps partiel travaille ». Cette distinction est fondamentale pour garantir une juste compensation en temps : un jour de RTT a pour objet de compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ; il doit donc logiquement être posé sur un jour qui aurait dû être travaillé. En omettant de vérifier cette modalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.