Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle : Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 septembre 2025, Pourvoi n° 23-21.837
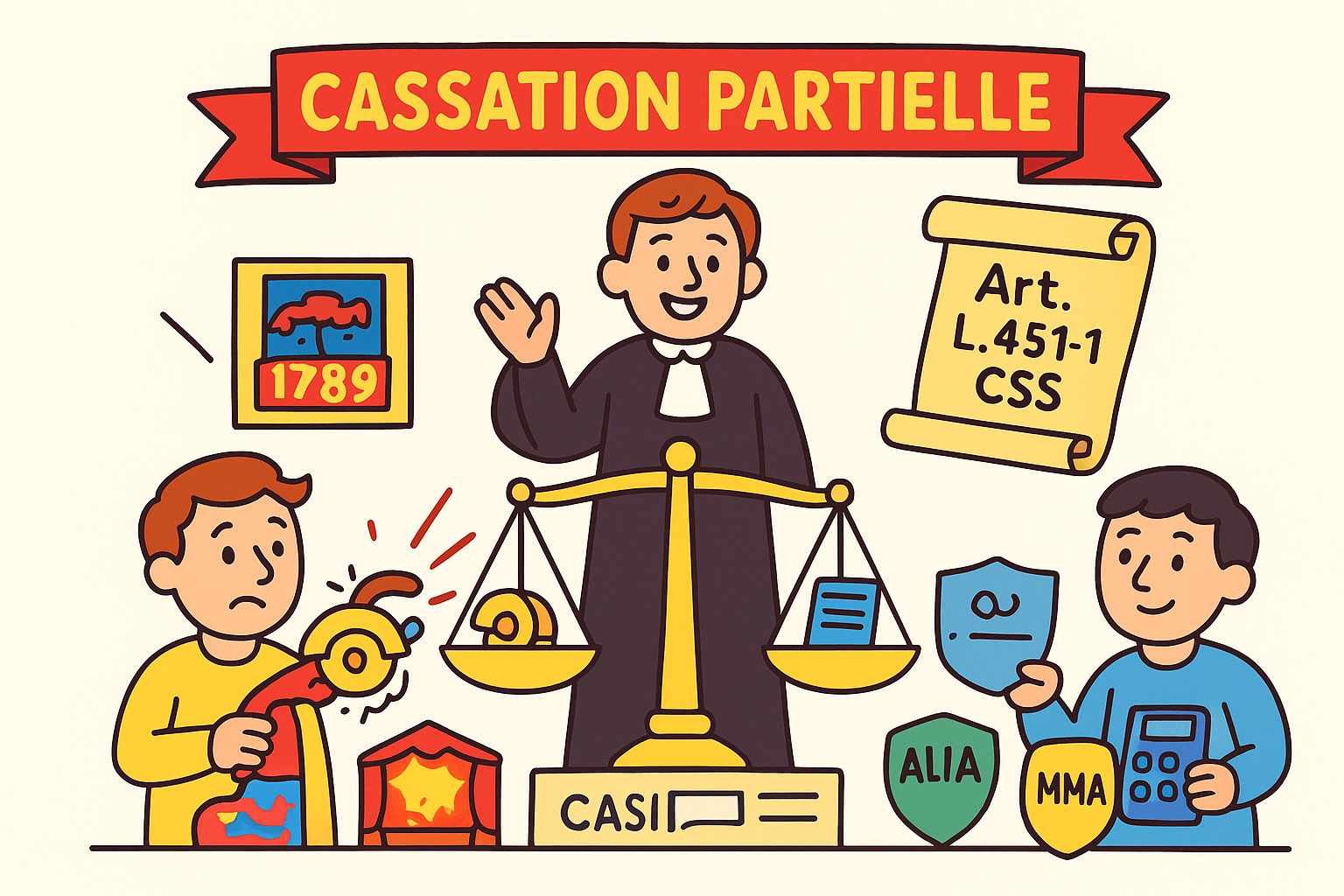
I. Rappel des faits
Le 8 novembre 2013, une explosion est survenue dans les locaux du Palais des Sports, loués par la société SEPS à la société de production NTCA pour la comédie musicale « 1789 les Amants de la Bastille ». L'accident, causé par la manipulation d'une disqueuse par un salarié de NTCA à proximité de produits pyrotechniques, a provoqué la mort du directeur technique de NTCA et a blessé plusieurs salariés des deux sociétés.
II. Étapes de la procédure et prétentions des parties
- Procédure pénale : Par un arrêt définitif du 28 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a déclaré les sociétés NTCA et SEPS coupables d'homicide et de blessures involontaires, fixant leurs parts de responsabilité respectives à 70 % pour NTCA et 30 % pour SEPS.
- Indemnisation : La SEPS a été condamnée à indemniser les salariés de NTCA victimes de l'accident. Parallèlement, une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a été engagée par ces mêmes salariés pour faire reconnaître la faute inexcusable de leur employeur, NTCA.
- Action en remboursement : La société NTCA et son assureur, Allianz, ont assigné la SEPS et son assureur, MMA, devant le tribunal de commerce pour obtenir le remboursement des sommes qu'elles ont versées (directement ou via la caisse de sécurité sociale) aux salariés victimes.
- Prétention de la SEPS (défenderesse) : En défense, la SEPS a opposé une exception de compensation. Elle a demandé que sa dette envers NTCA soit compensée par les sommes qu'elle-même avait versées aux salariés de NTCA, en arguant que NTCA devait contribuer à cette indemnisation à hauteur de sa part de responsabilité de 70 %.
III. Présentation de la thèse opposée à celle de la Cour de cassation
La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 30 août 2023, a accueilli favorablement l'argument de la SEPS. Elle a jugé que la SEPS était recevable à opposer la compensation. Pour ce faire, elle s'est fondée sur le partage de responsabilité (70 %/30 %) établi par le juge pénal et a explicitement écarté l'application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, considérant que ce texte ne faisait pas échec au mécanisme de la compensation.
IV. Problème de droit
Un tiers coresponsable d'un dommage constitutif d'un accident du travail, qui a indemnisé les salariés de l'employeur, peut-il opposer à cet employeur une compensation fondée sur le partage de responsabilité, nonobstant l'immunité dont bénéficie l'employeur en vertu du régime spécial des accidents du travail ?
V. Réponse donnée par la Cour de cassation
La Cour de cassation répond par la négative et casse et annule l'arrêt d'appel sur ce point.
Elle rappelle qu'en application des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, un tiers étranger à l'entreprise (la SEPS) qui a indemnisé la victime d'un accident du travail ne dispose d'aucun recours contre l'employeur (NTCA), sauf en cas de faute intentionnelle de ce dernier.
La Cour en déduit qu'en l'absence de faute intentionnelle de NTCA, la SEPS ne détenait aucune créance en contribution à son encontre pour les sommes versées aux victimes. Par conséquent, la condition de réciprocité des dettes faisant défaut, le mécanisme de la compensation ne pouvait pas être mis en œuvre pour éteindre la dette de la SEPS envers NTCA. En statuant autrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Commentaire d'arrêt
Cet arrêt, rendu par la deuxième chambre civile le 18 septembre 2025, offre une clarification essentielle sur l'articulation entre le régime spécial des accidents du travail et les mécanismes de droit commun de la responsabilité, en particulier la compensation. La Cour de cassation réaffirme avec force l'étanchéité du principe d'immunité de l'employeur face aux recours des tiers coauteurs du dommage. La solution s'articule autour de deux axes : la confirmation de la primauté du régime dérogatoire sur le droit commun de la responsabilité (I) et le rejet de la compensation comme un moyen de contournement de ce régime (II).
I. La primauté du régime spécial de l'accident du travail sur le droit commun de la responsabilité
La Cour de cassation rappelle que le régime de l'accident du travail constitue un bloc normatif qui fait obstacle aux actions de droit commun, y compris celles exercées par un tiers coresponsable. Cette solution repose sur une interprétation stricte de l'immunité de l'employeur (A), dont la seule brèche réside dans la faute intentionnelle, à l'exclusion de la faute inexcusable (B).
A. Le principe intangible de l'immunité de l'employeur face au recours du tiers coresponsable
La Cour de cassation fonde sa décision sur un principe cardinal du droit de la sécurité sociale, énoncé au paragraphe 12 : le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé une victime d'accident du travail n'a pas de recours contre l'employeur. Cette immunité, issue de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, instaure un système de réparation forfaitaire et clôt le débat sur la responsabilité de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi.
"L'intérêt de l'arrêt réside dans le fait que cette immunité est maintenue y compris dans un contexte de coresponsabilité pénalement reconnue."
L'intérêt de l'arrêt réside dans le fait que cette immunité est maintenue y compris dans un contexte de coresponsabilité pénalement reconnue. Bien que l'arrêt pénal du 28 novembre 2018 ait établi une responsabilité partagée (70 % pour l'employeur NTCA, 30 % pour le tiers SEPS), la Cour de cassation juge que ce partage est sans effet sur l'action récursoire du tiers contre l'employeur. L'immunité est donc absolue et fait écran à toute tentative du tiers d'obtenir une contribution de l'employeur, même si la faute de ce dernier est prépondérante dans la survenance du dommage.
B. La distinction cruciale entre faute inexcusable et faute intentionnelle
L'arrêt souligne, en creux, la distinction fondamentale entre la faute inexcusable et la faute intentionnelle de l'employeur. Si les salariés de NTCA ont pu, par une procédure distincte, obtenir une majoration de leurs indemnités sur le fondement de la faute inexcusable de leur employeur, cette qualification n'ouvre aucune brèche dans l'immunité de ce dernier vis-à-vis des tiers. La faute inexcusable ne produit d'effets que dans la relation entre le salarié, la caisse et l'employeur.
En visant l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, la Cour rappelle que seule la faute intentionnelle de l'employeur est de nature à lever son immunité et à le réintégrer dans le champ du droit commun de la responsabilité. C'est uniquement dans cette hypothèse, non caractérisée en l'espèce, que le tiers coauteur du dommage (SEPS) aurait pu exercer un recours contre l'employeur (NTCA). En l'absence de faute intentionnelle, le principe d'immunité demeure total et s'oppose à toute action récursoire
II. Le rejet de la compensation comme voie de contournement de l'immunité
Fort de ce principe, la Cour de cassation en tire les conséquences logiques sur le terrain du droit des obligations. Elle censure l'arrêt d'appel qui avait admis une compensation, considérant qu'un tel mécanisme ne peut être utilisé pour contourner une interdiction légale. Cette solution repose sur une analyse rigoureuse des conditions de la compensation (A) et réaffirme la portée d'ordre public du régime des accidents du travail (B).
A. L'impossible compensation en l'absence de créance récursoire
La cour d'appel avait tenté de concilier le partage de responsabilité avec le droit des obligations en validant une "compensation judiciaire". La Cour de cassation censure ce raisonnement en revenant à la source même de la compensation : l'existence de deux dettes réciproques. Au paragraphe 16, elle énonce clairement que la SEPS "ne disposait [...] d'aucune créance en contribution" contre NTCA.
"La Cour de cassation censure ce raisonnement en revenant à la source même de la compensation : l'existence de deux dettes réciproques."
En effet, l'immunité édictée par le code de la sécurité sociale n'est pas une simple fin de non-recevoir ; elle empêche la naissance même d'une créance dans le patrimoine du tiers. La SEPS, n'ayant aucun droit d'agir contre NTCA pour obtenir le remboursement partiel des indemnités versées, n'est donc créancière de rien. Sans créance, il ne peut y avoir de compensation. La Cour de cassation refuse ainsi que la compensation devienne un moyen détourné de réaliser ce que la loi interdit expressément : l'exercice d'une action récursoire contre l'employeur.
B. La portée de la solution : une clarification protectrice du régime spécial
En cassant l'arrêt d'appel, la Cour de cassation adresse un message clair : l'architecture du régime des accidents du travail ne peut être altérée par les mécanismes du droit civil. La solution adoptée par la cour d'appel, bien que semblant équitable au regard du partage de responsabilité, aurait créé une brèche dangereuse dans l'immunité de l'employeur. Elle aurait permis à tout tiers coresponsable de contourner l'interdiction de recours en se prévalant d'une compensation.
"La décision renforce ainsi le caractère d'ordre public du monopole de la sécurité sociale en matière d'indemnisation des accidents du travail."
La décision renforce ainsi le caractère d'ordre public du monopole de la sécurité sociale en matière d'indemnisation des accidents du travail. Elle rappelle aux tiers qui contractent avec des entreprises que le risque de causer un dommage à un salarié de leur cocontractant leur impose une diligence accrue, car ils ne pourront, sauf faute intentionnelle, se retourner contre l'employeur pour partager le fardeau de l'indemnisation. L'arrêt constitue donc une importante veille jurisprudentielle pour tous les praticiens du droit de la responsabilité et de l'assurance.